À l’aide de documents, de peintures et d’objets d’art, dont certains proviennent de musées américains, l’exposition Versailles et l’Indépendance américaine dévoile le rôle joué par le royaume de France dans la guerre des « Insurgents » contre l’Angleterre, jusqu’à la signature du traité de Paix en 1783 à Versailles.
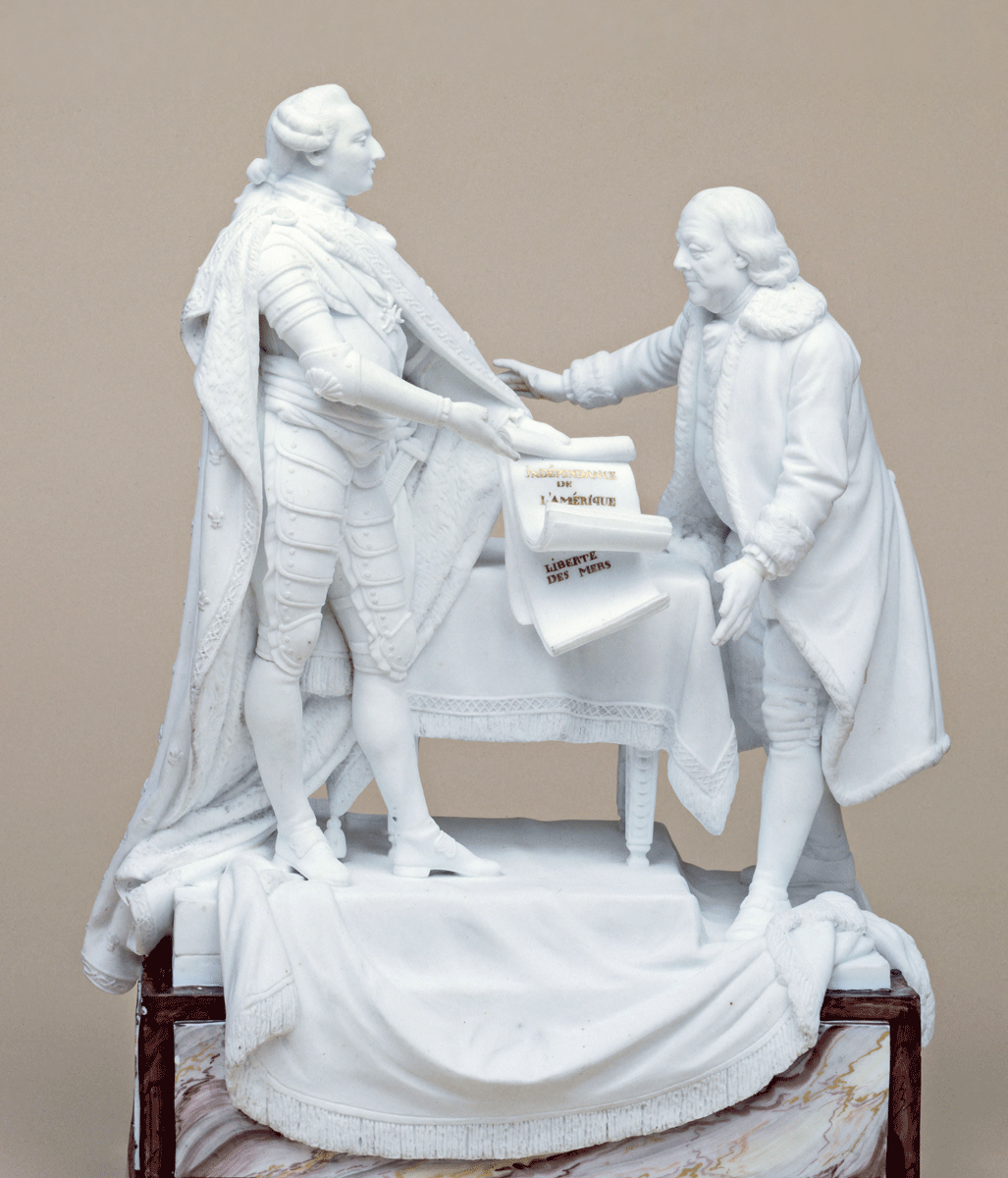
Louis XVI remettant à Benjamin Franklin les traités signés entre la France et les Etats-Unis, le 6 février 1778, Charles Gabriel Sauvage dit Lemire-Sauvage, biscuit de Sèvres. Paris, musée Carnavalet
L’ensemble des témoignages dont les historiens disposent pour retracer la chronologie de l’Indépendance américaine converge en un point : la complexité d’un événement qui a eu des répercussions au-delà de l’Atlantique, en Europe et même dans le monde entier. Et vice-versa : la France, mais également l’Espagne et la Hollande, ont joué un rôle déterminant dans cette révolution, d’autant plus difficile à cerner que l’alliance avec les « Insurgents » américains s’appuie sur une tension politique nouvelle : de vieilles monarchies se réclamant de l’absolutisme soutiennent la naissance du premier système démocratique moderne. L’intervention décisive de l’Europe catholique dans le conflit entre les Britanniques et les futurs Américains est, par exemple, exprimée sans ambages par Alexander Hamilton, entré sous le commandement de George Washington en mars 1777 : « Nos concitoyens ont la bêtise de l’âne et la passivité du mouton. […] Ils sont absolument déterminés à ne jamais être libres. […] Si nous devons être sauvés, ce sera par la France et par l’Espagne. »
Ces méchants mots ne rendent pas justice aux milliers de pauvres encouragés à coups de bâtons, d’hypothétiques promesses de terres et d’ascension sociale, à combattre et à mourir pour une nation qui n’était pas encore née. À propos de ces régiments de chair à canon nés sur le sol américain, Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort a d’ailleurs diffusé une anecdote aujourd’hui bien connue : « Pendant la guerre d’Amérique, un Écossais disait à un Français, en lui montrant quelques prisonniers américains : “Vous vous êtes battu pour votre maître ; moi, pour le mien ; mais ces gens-ci, pour qui se battent-ils ? Ce trait vaut bien celui du Roi de Pegu, qui pensa mourir de rire en apprenant que les Vénitiens n’avoient pas de roi” ». Si l’on se souvient de l’Histoire populaire américaine d’Howard Zinn, on reconnaîtra que la question de l’Écossais n’était pourtant pas si absurde : « […] la réalité que dissimulait le vocabulaire de la Déclaration d’indépendance (rédigée la même année que le manifeste capitaliste d’Adam Smith, La Richesse des nations) était qu’une classe montante composée de notables devait nécessairement rallier suffisamment d’Américains pour battre l’Angleterre sans pour autant bouleverser outre mesure les rapports tissés entre argent et pouvoir pendant les quelques cent cinquante ans d’existence des colonies. D’ailleurs, 69 % des signataires de la Déclaration d’indépendance avaient occupé des postes d’administrateurs coloniaux sous l’autorité de l’Angleterre. » Une fois encore, s’invite ici l’inextricable complexité du contexte politique ayant abouti à la Déclaration d’Indépendance américaine.

Join or die, Benjamin Franklin, 9 mai 1754, gravure sur bois. © Washington, Library of Congress.
La gravure « Join or die » (soit : « s’unir ou périr») illustre, quant à elle, l’évolution des relations avec la France. Si chaque morceau du serpent renvoie aux initiales d’une colonie américaine, l’appel à l’union ne faisait pas référence, au départ, à la révolte contre les Britanniques, mais à la guerre de Sept Ans, gagnée par l’Angleterre contre la France et plusieurs tribus indiennes. Attribué à Benjamin Franklin et publié le 9 mai 1754, le message politique d’origine était donc destiné à combattre les Français. Ce n’est qu’ensuite qu’il fut récupéré et utilisé comme symbole d’unité nationale par les révolutionnaires américains contre le colon anglais. Pour saisir ce glissement sémantique, revenir aux relations qu’entretiennent France et Angleterre est indispensable. Les deux royaumes ne s’entendent guère, depuis longtemps. Dans son pamphlet Le Sens Commun (1776), Thomas Paine, né britannique, devenu révolutionnaire américain, puis député français élu à l’Assemblée nationale en 1792, livre une analyse toute personnelle de la discorde entre les deux pays européens et des bases de l’entente franco-américaine : il accuse la famille royale installée à Londres d’être issue d’« un bâtard français débarquant avec sa horde de malfrats et s’instituant lui-même roi d’Angleterre contre le consentement des indigènes ». De manière plus objective, il apparaît que Versailles, en s’engageant aux côtés de George Washington, a moins suivi les voix vibrantes de la liberté des peuples à s’éduquer par eux-mêmes que manœuvré contre l’Angleterre victorieuse de l’humiliant traité de Paris de 1763, qui fit perdre à la France de nombreuses colonies.

Les Commissaires du Traité de Paris, vers 1783, d’après Benjamin West. L’œuvre était destinée à immortaliser la signature du traité de paix entre les Américains et la Grande Bretagne, le 3 septembre 1783 à l’Hôtel d’York, en même temps que le traité de Versailles. La partie droite du tableau ne fut jamais achevée, le Britannique ayant refusé de venir poser pour le peintre.
Il n’en reste pas moins que, du Marquis de Condorcet à Alexis de Tocqueville, la déclaration d’Indépendance du 4 juillet et la constitution de 1787 ont fourni les premiers élans d’un nouveau modèle d’organisation politique et sociale, fondé sur le principe du respect des libertés individuelles. Et que sur les bases de cette alliance, au départ plus diplomatique qu’idéologique, allait s’épanouir l’amitié franco-américaine. L’entrepreneur et philanthrope John Davidson Rockefeller Junior fut l’un des grands acteurs de cette fraternité transatlantique, lui qui en 1924 fit un don considérable pour la restauration du Château, non seulement par amour de l’art mais aussi par attachement à un peuple français qu’il admirait « pour sa belle humeur » et « son fier courage ».
Victor Guégan
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°9 (avril – septembre 2016).
Commémorer les grandes batailles américaines en peinture
Louis XVI et Louis-Philippe – qui confiera à l’une des figures de la guerre de l’Indépendance américaine, Lafayette, le commandement de la garde nationale – tentèrent de s’appuyer sur la victoire franco-américaine aux côtés des insurgés pour asseoir leur légitimité politique. Cette volonté aboutit à deux commandes officielles en 1786 et en 1836, qui constituent des témoignages précieux de l’importance symbolique et historique de cet événement en France.
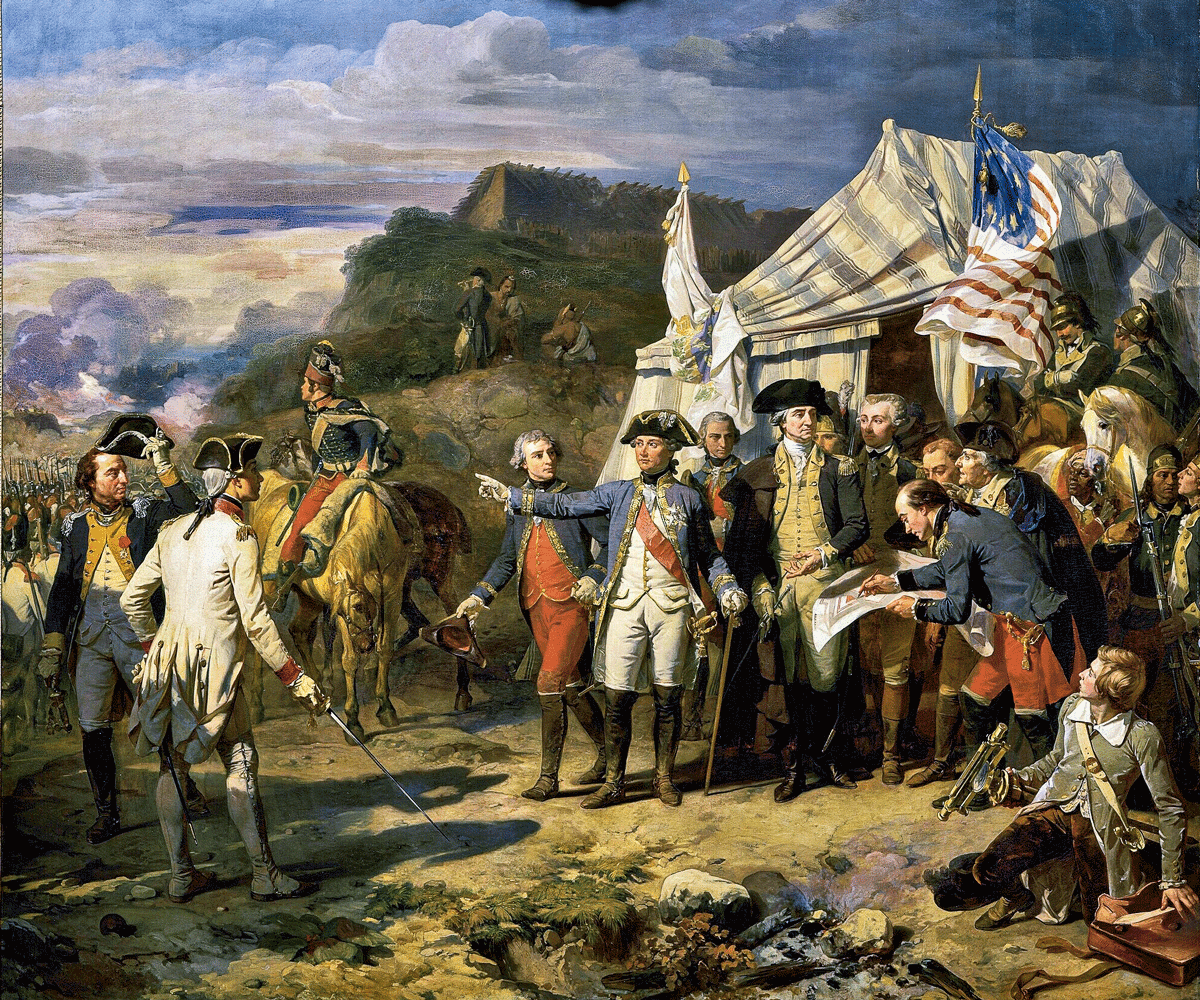
Le Siège de Yorktown, le 17 octobre 1781, par Auguste Couder (1790-1873), musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin
Les Français au siège de Yorktown
L’œuvre célèbre le siège de Yorktown, bataille décisive dans la guerre pour l’Indépendance. Celle-ci n’aura pas à être déplacée pour l’exposition : le visiteur de Versailles l’aura peut-être déjà contemplée parmi les tableaux de la galerie des Batailles commandés par Louis-Philippe pour le musée d’Histoire de France. Peinte en 1836, elle participe à ce programme de la monarchie de Juillet visant à associer l’héritage militaire glorieux de l’Ancien Régime et celui de la Révolution. Pour cela, Auguste Couder a pris soin de figurer une galerie de personnages politiques français de premier plan, de Rochambeau à La Fayette. Indissociable de la bataille de Chesapeake, le 5 septembre 1781, la capitulation de Yorktown constitue l’une des victoires décisives de la guerre non seulement parce qu’elle permet la prise de New York, mais aussi, ainsi que le souligne l’historien Olivier Chaline, dans le sens où ces deux combats firent que « les Britanniques perdirent l’espoir de venir à bout des Insurgents ».
Les 18 toiles de la victoire franco-américaine
En 1786, Louis XVI passe commande d’une série de dix-huit toiles rendant hommage aux principales victoires navales contre les Anglais lors de la guerre d’Amérique à Auguste-Louis de Rossel (1736-1804). Rossel, officier, a notamment participé à la guerre d’Indépendance en combattant à Ouessant, le 27 juillet 1778. Il s’est rapidement retiré suite à des problèmes de santé, en 1779, pour se consacrer à la peinture.
À VOIR
Versailles et l’Indépendance américaine
du 5 juillet au 2 octobre 2016
Galerie des Batailles
horaires : Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 18h30
billets : Passeports et billet Château
Gratuit et illimité avec la carte « 1 AN À VERSAILLES »
À LIRE
Le catalogue d’exposition Versailles et l’Indépendance américaine
Sous la direction de Valérie Bajou
Coédition château de Versailles/ Gourcuff Gradenigo
L’album de l’exposition
écrit par Valérie Bajou, commissaire de l’exposition
Bilingue français/anglais