Cette expression a été employée pour rendre compte de la véritable frénésie constructive du comte d’Artois. Faute de moyens financiers, les projets du prince n’aboutiront pas toujours, mais ils donnent l’occasion d’apprécier, dans l’exposition au château de Maisons, les plans et aquarelles de son fidèle architecte, François-Joseph Bélanger.
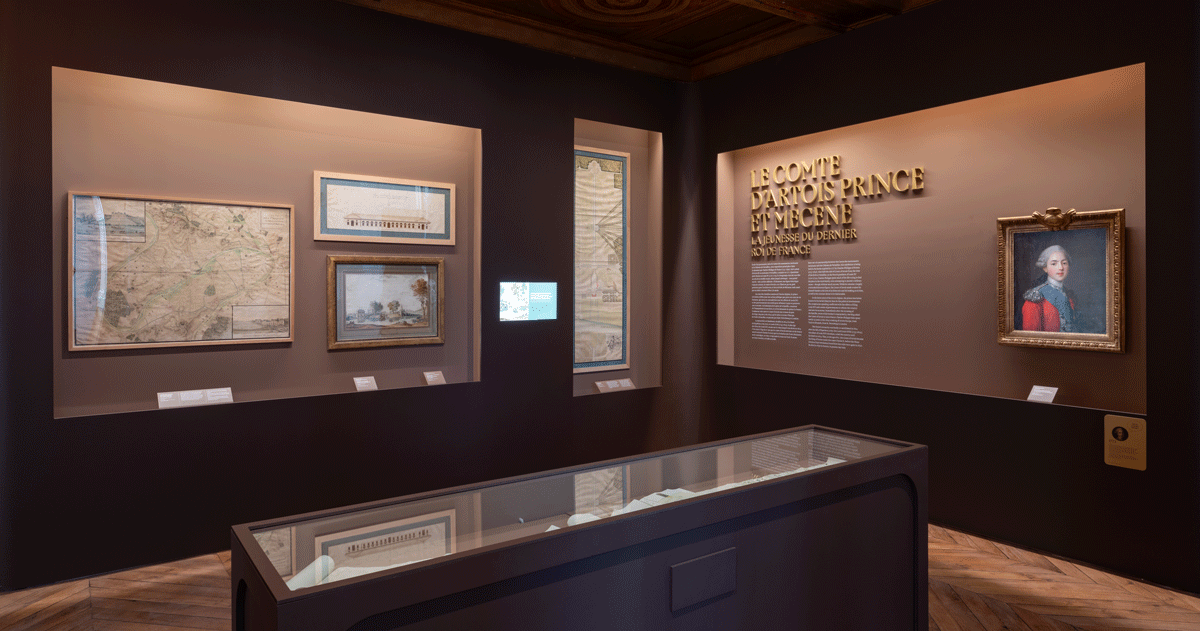
Salle d’ouverture de l’exposition Le comte d’Artois, prince et mécène. La jeunesse du dernier roi de France au château de Maisons.
© EPV / Thomas Garnier
L’acquisition du château de Maisons, chef-d’œuvre de François Mansart, est à la hauteur des ambitions du jeune frère de Louis XVI. Jacques-François Blondel (1705-1774), théoricien et professeur à l’Académie royale d’architecture, considérait cet édifice comme le modèle de l’architecture classique à la française. Déjà propriétaire du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye ainsi que de nombreuses terres situées entre les deux sites, le comte d’Artois les réunit en rachetant le fief de Belloy, en 1778, et le domaine de Carrières, dont il démolit le château en 1783 pour y chasser.
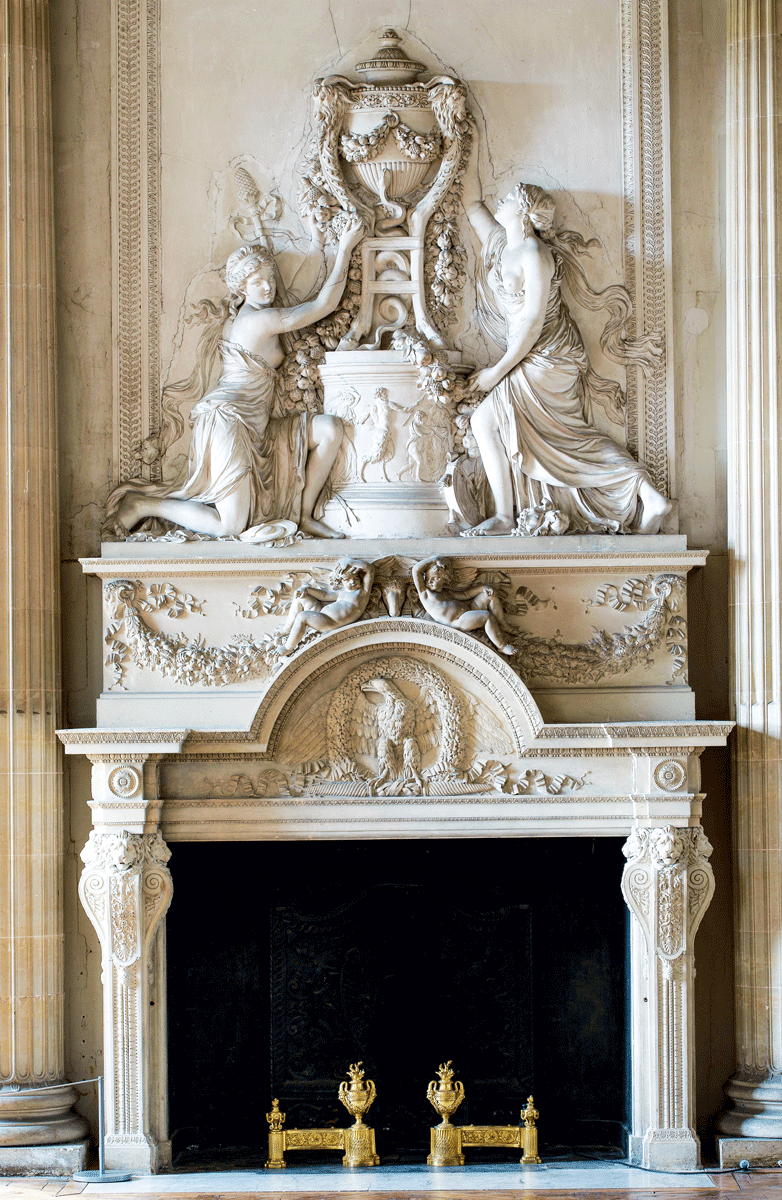
La cheminée de la salle à manger du château de Maisons, avec son décor fastueux sculpté par Nicolas Lhuillier. © Centre des monuments nationaux / Pascal Lemaître
La salle à manger de Maisons
Grand amateur de chevaux, le prince jette son dévolu sur Maisons pour son écurie monumentale et ses occupants de race anglaise. À cette époque, le château est alors relativement délabré. Le comte confie à Radix de Sainte-Foy, surintendant des bâtiments du prince, sa restauration et celle de ses communs. Entre 1777 et 1782, François-Joseph Bélanger y déploie son talent, notamment dans l’aile droite du château où il aménage un appartement du déjeuner. Dans la salle à manger, le premier architecte du comte d’Artois s’associe au sculpteur Nicolas Lhuillier pour élaborer un décor particulièrement riche, mêlant la pierre et le stuc.
La cheminée y tient une place particulière, tant par sa taille que par l’importance de ses sculptures. Sa structure, inhabituelle pour le dernier quart du XVIIIe siècle, est proche des cheminées à la française. Lhuillier décrit avec minutie ses propres sculptures du nouveau manteau, notamment le motif d’aigle éployé tenant dans ses serres une couronne de feuilles nouée d’un ruban. L’artiste s’est inspiré directement d’un dessin qu’il avait lui-même réalisé à Rome, quand il était dans l’atelier de Piranèse, probablement entre 1755 et 1768. Il s’agit ainsi de l’exemple le plus marquant en France de l’imitation des cheminées de Piranèse.
« Les baies et les niches abritent les sculptures qui font la gloire
de cette pièce, commandées aux plus grands artistes du temps. »
Classicisme et néo-classicisme
Les baies et les niches abritent les sculptures qui font la gloire de cette pièce, commandées aux plus grands artistes du temps. Elles figurent les quatre saisons : Flore, par Jean-Joseph Foucou pour le printemps ; Pomone, par Louis-Simon Boizot pour l’été ; Erigone, par Clodion, pour l’automne ; Cérès, par Jean-Antoine Houdon, pour l’hiver. Bélanger compose le plafond en disposant neuf caissons ornés de bas-reliefs. Quant aux murs, ils disparaissent sous le jeu des colonnes et pilastres corinthiens cannelés. L’architecte a dessiné le moindre ornement, assurant une remarquable unité de décor. Cet ensemble somptueux respecte ainsi l’esprit de l’œuvre de François Mansart, témoignant d’une démarche conjuguant classicisme et néo-classicisme.
Clotilde Roy,
chef du pôle de la coordination scientifique et technique à la Direction de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°27 (octobre 2025 – mars 2026).
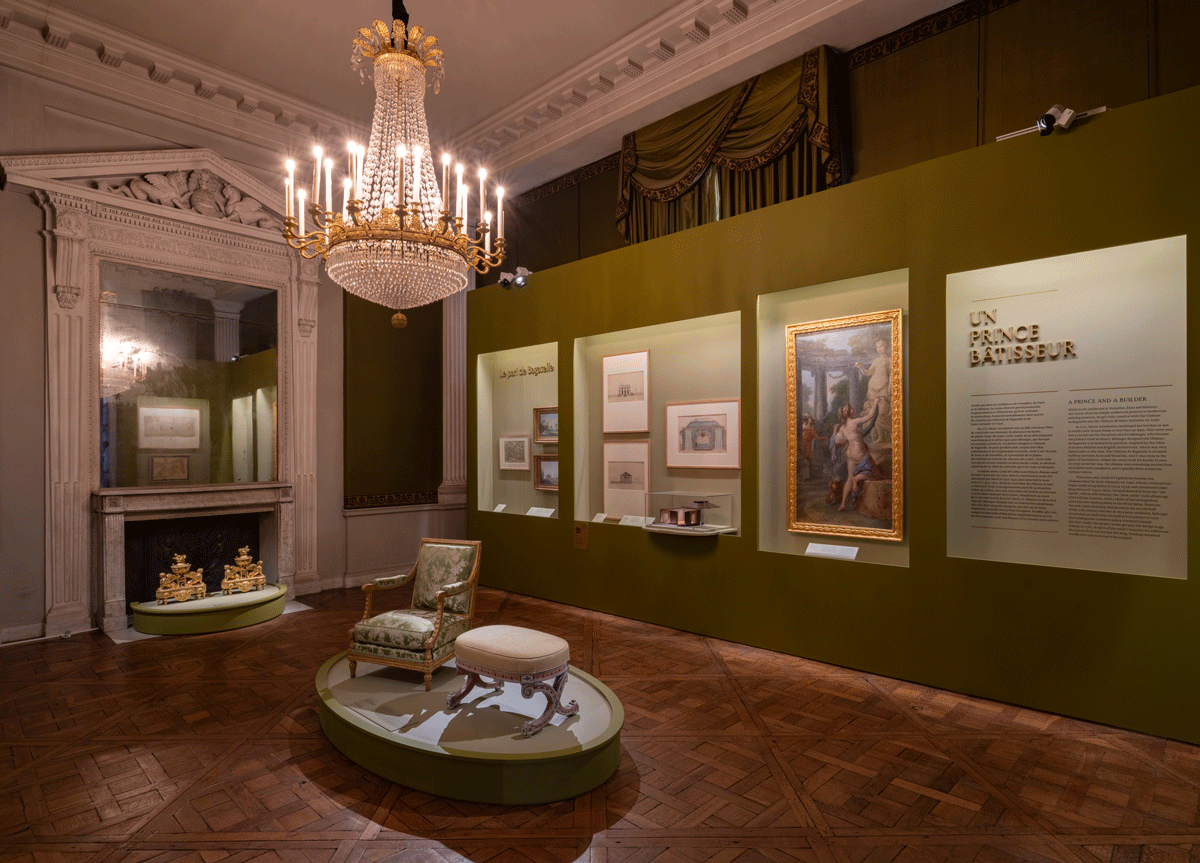
Salle d’exposition consacrée au comte d’Artois intitulée « Un prince bâtisseur ». © EPV / Thomas Garnier
Le château et les jardins de Bagatelle, un pari et une folie
Le petit château de Bagatelle est un autre témoignage, d’un raffinement extrême, de la passion du comte d’Artois pour l’architecture. Acheté en 1775, il est confié à Bélanger pour relever le pari que le prince vient de prendre avec la reine Marie-Antoinette : reconstruire le château à son goût en moins de trois mois ! Fin 1777, les travaux sont terminés, pour le gros œuvre, au bout de soixante-quatre jours.
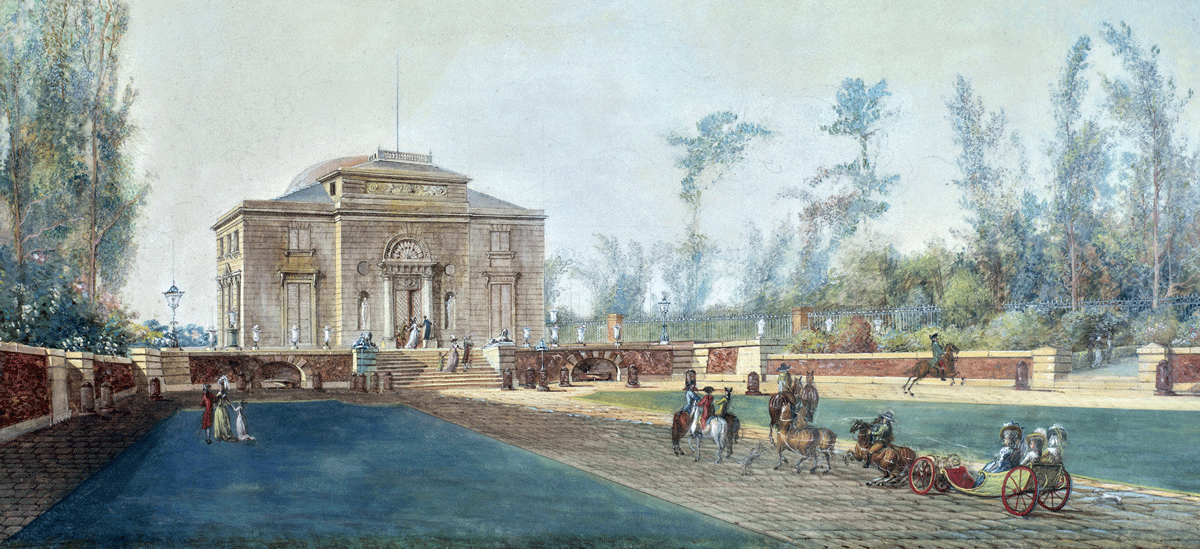
Vue du pavillon de Bagatelle [détail], par Louis Belanger, 1785, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
© EPV / Christophe Fouin. Dessin acquis récemment par le château de Versailles, en novembre 2024.
Boudoirs turcs
De Bagatelle au Temple, le comte d’Artois apparaît comme un réel précurseur dans le domaine du décor et des arts décoratifs. C’est en effet le premier membre de la famille royale à succomber à la mode du goût turc, dernier développement d’un intérêt déjà ancien pour l’Orient. Ce goût s’incarne dans les décors raffinés de petits cabinets que le comte fait réaliser à Versailles (1777 et 1781) ou au Temple (1777).
Alors que le second cabinet turc de Versailles fait la part belle aux panneaux peints de personnages enturbannés et de sultanes alanguies, celui du Temple se caractérise par un décor textile composé de festons sur le pourtour de la pièce retenus par des croissants de lune en métal. C’est pour ce cabinet que furent réalisés les sièges de Jacob présentés lors de l’exposition dont l’ornementation file la métaphore orientale : cornes d’abondance, chapelets de perles, pieds en sabre, croissants de lune.
B. D.
À VOIR
Exposition Le comte d’Artois, prince et mécène. La jeunesse du dernier roi de France
Du 14 novembre 2025 au 2 mars 2026
CHÂTEAU DE MAISONS
Pour accompagner cette exposition, le château de Maisons propose une programmation culturelle variée : visites libres, visites guidées, conférences avec des spécialistes, visites thématiques, visites chantées. Un livret-jeu conçu pour l’exposition sera disponible pour le public familial.
Billets et tarifs sur chateau-maisons.fr
À LIRE
Le catalogue de l’exposition
Coédition château de Versailles / Éditions du patrimoine, collection « Regards », 96 p., 26 × 26 cm, novembre 2025, 16 €.