Déployé sur une vaste terrasse dominant l’orangerie, le parterre du Midi mérite la plus grande attention. Sa restauration a redonné toute sa vigueur à une composition d’André Le Nôtre emblématique de l’histoire des jardins, dont Pierre Bortolussi nous livre les arcanes.
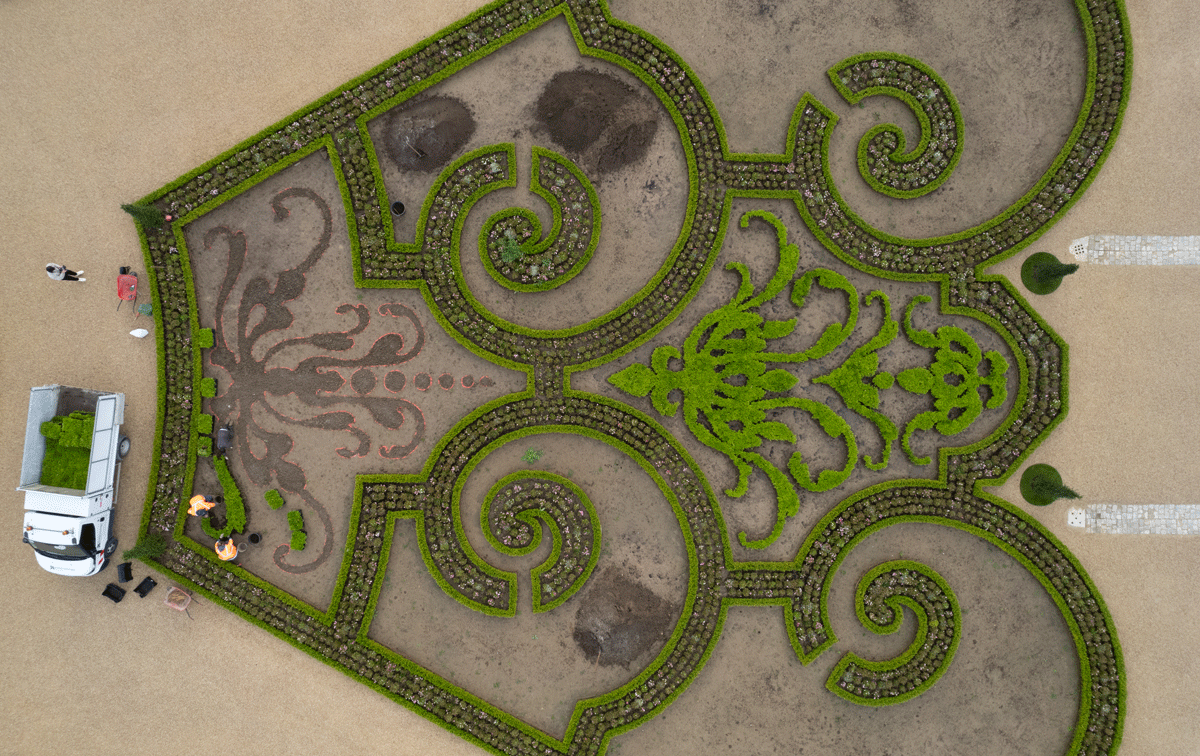
Plantation des buis composant la broderie du parterre du Midi, en octobre dernier. © EPV / Thomas Garnier
Pourquoi restaurer aujourd’hui ce parterre, disposé au pied du château ?
Le parterre du Midi était arrivé à grande maturité : développés au maximum de leurs possibilités, les buis étaient exsangues, les topiaires1 avaient considérablement engraissé, l’if ne supportant pas d’être rabattu profondément lors de sa taille. Par ailleurs, les fleurissements avaient peu à peu engoncé les buis. À force de bêcher la surface chaque année, et de la recharger en vue d’y planter, c’était presque vingt centimètres d’épaisseur de terre qui s’étaient accumulés autour d’eux.
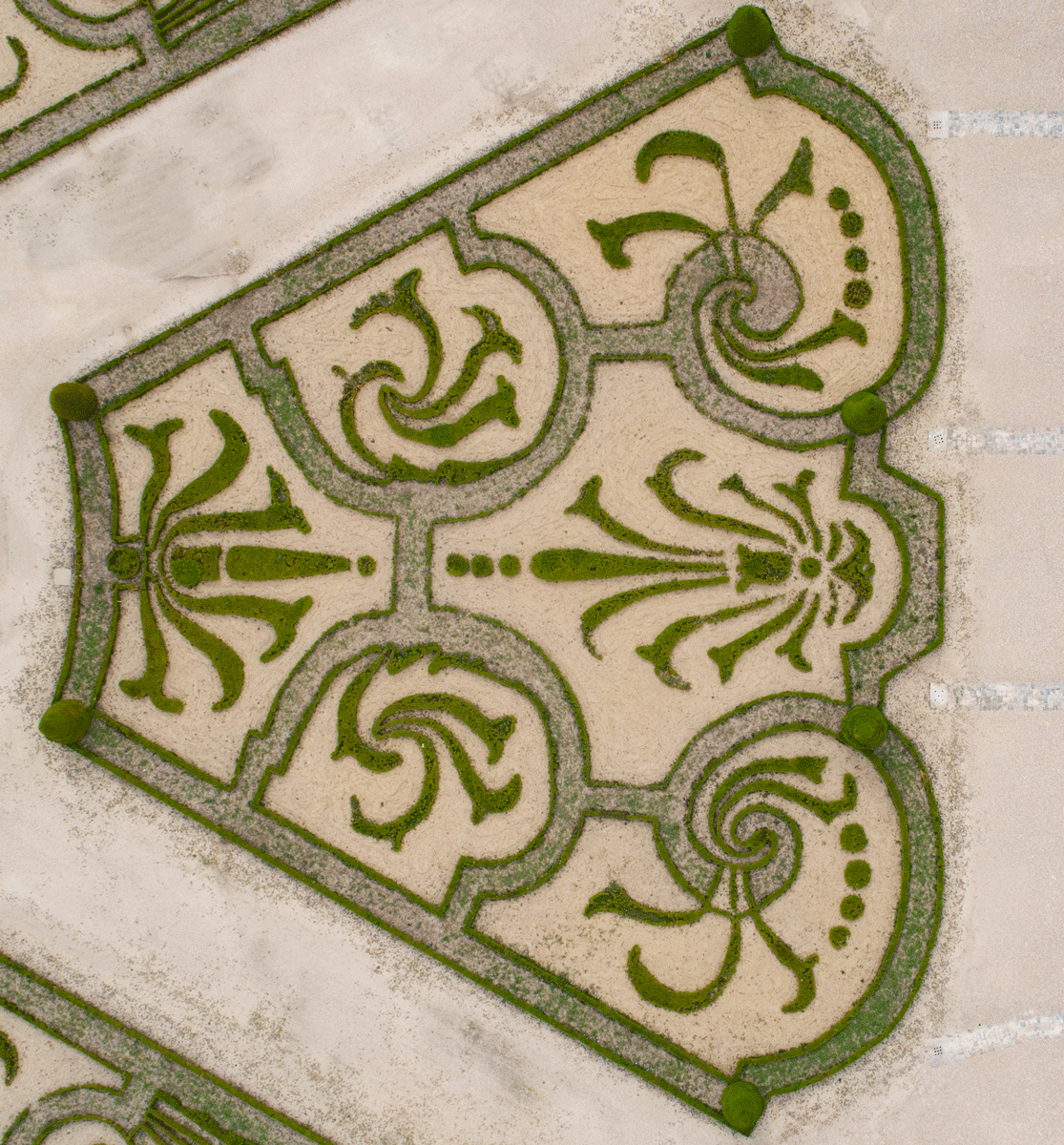
Le parterre du Midi en juin 2020, avant sa restauration.
© EPV / Thomas Garnier
Il s’agissait donc de reprendre l’histoire de ces lieux et de retrouver leur état d’Ancien Régime, perdu au cours du XIXe siècle. Très certainement délaissé à la Révolution, le parterre du Midi se trouvait réduit, dans les années 1810, à « de grandes pièces de gazon et de simples bordures ». En 1860, il comportait à nouveau des broderies, mais simplifiées et épaissies. Au début du XXe siècle, les photographies le montrent envahi par les massifs de fleurs, alors très prisés, faisant oublier durablement la primauté du dessin en cet espace central, fait pour être contemplé depuis les appartements royaux, au premier étage, et ouvrant la perspective au sud.
Ce parterre ne fait-il pas partie des tout premiers qui ont été conçus par le célèbre jardinier André Le Nôtre ?
C’était l’un des plus beaux de Versailles. Il présentait une broderie d’une finesse qui n’existe, de nos jours, nulle part ailleurs, ni en France ni à l’étranger. Il fallait absolument en restituer le raffinement. Nous n’avons malheureusement pas trouvé d’écrit le confirmant, mais tout porte à croire que Le Nôtre est intervenu dès sa première version, dans les années 1660, où il était déjà chargé des jardins. Ce premier aménagement suit une composition qui va perdurer : quatre compartiments triangulaires pointés vers le centre – occupé par un bassin – et ceinturés d’un passe-pied ou d’une plate-bande périphérique. Comme le prouvent certains documents datant de 1682, des broderies ornaient déjà ces compartiments avant que soient lancés, un an plus tard, les travaux de Jules Hardouin-Mansart.
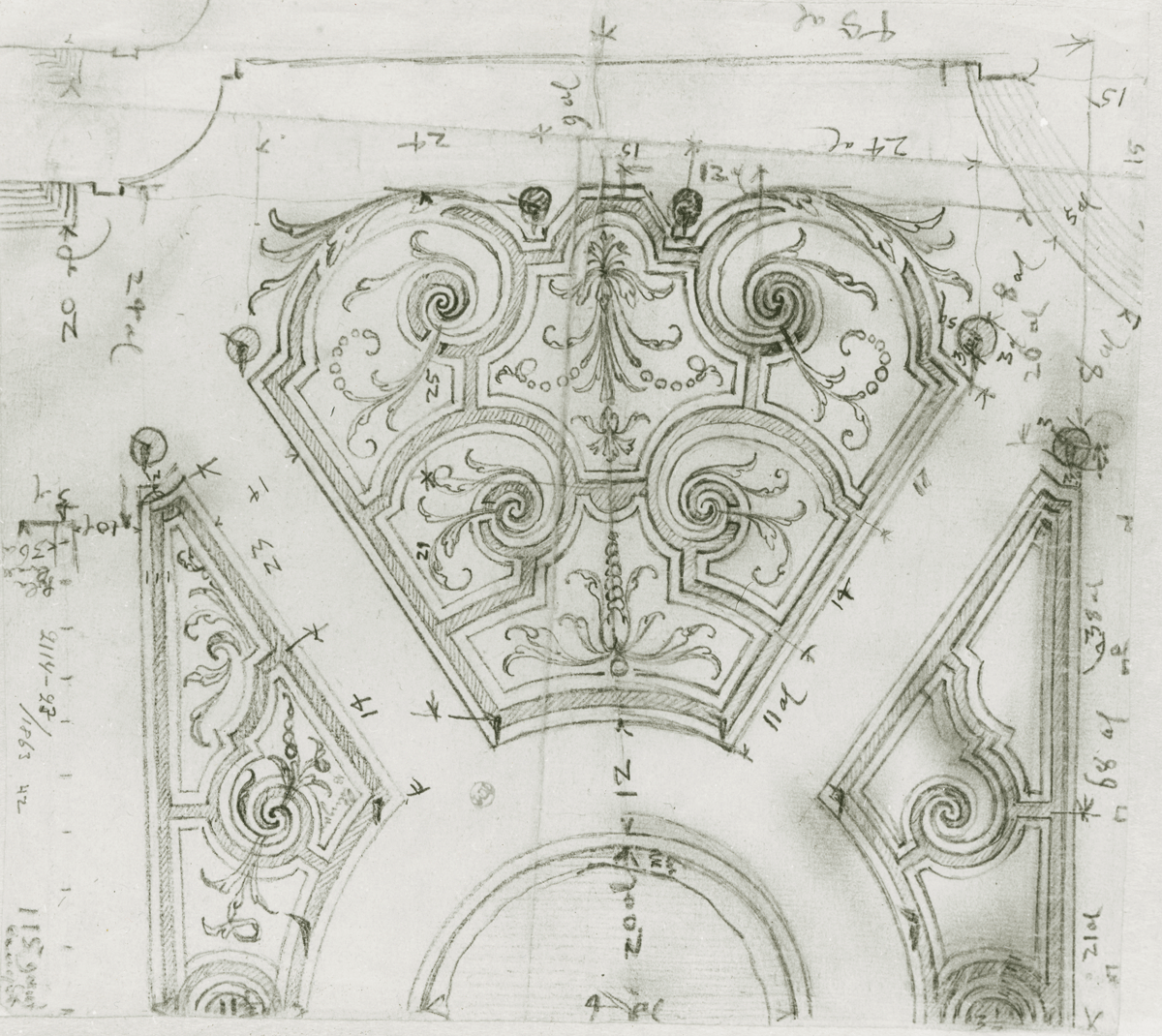
La Broderie du parterre du Midi, carnet d’esquisses de Tessin p. 42, 1687, Stockholm, Nationalmuseum. © Stockholm, Nationalmuseum / DR
La construction d’une nouvelle orangerie, beaucoup plus vaste, induisit le doublement vers le sud de la surface du parterre qui apparaît dès lors selon deux pièces symétriques, organisées chacune comme précédemment. Nous avons la chance, pour cet endroit, de disposer de nombreuses archives, écrites et figurées, qui nous ont permis de bien les cerner. Une merveilleuse esquisse de Carl Gustaf Tessin, réalisée en 1687, donne des indications très précises, avec des mesures chiffrées, sur les plates-bandes de gazon, représentées par des hachures, les haies de buis taillées et leurs enroulements de broderie !
Des fouilles de cette terrasse ont été menées préalablement aux travaux.
Vous ont-elles aidé à en comprendre l’histoire ?
J’avoue que j’étais un peu sceptique au début, mais le résultat de ces fouilles m’a stupéfait : il a permis de remonter jusqu’aux fosses de plantation datant du XVIIe siècle et d’attester ce qui est renseigné sur ce plan de Tessin. Chaque ancien plot de buis a été localisé, permettant de retracer tous les détails de la broderie, jusqu’aux « graines » qui prolongeaient les fleurons centraux et les rinceaux latéraux. Ces découvertes confirment la préciosité de ce parterre à l’époque. Même le dessin des feuilles d’acanthe qui pointaient hors de son cadre – ce qui était alors complètement novateur – a été mis au jour, ainsi que les disques de gazon sur lesquels se dressaient les topiaires aux angles des compartiments.
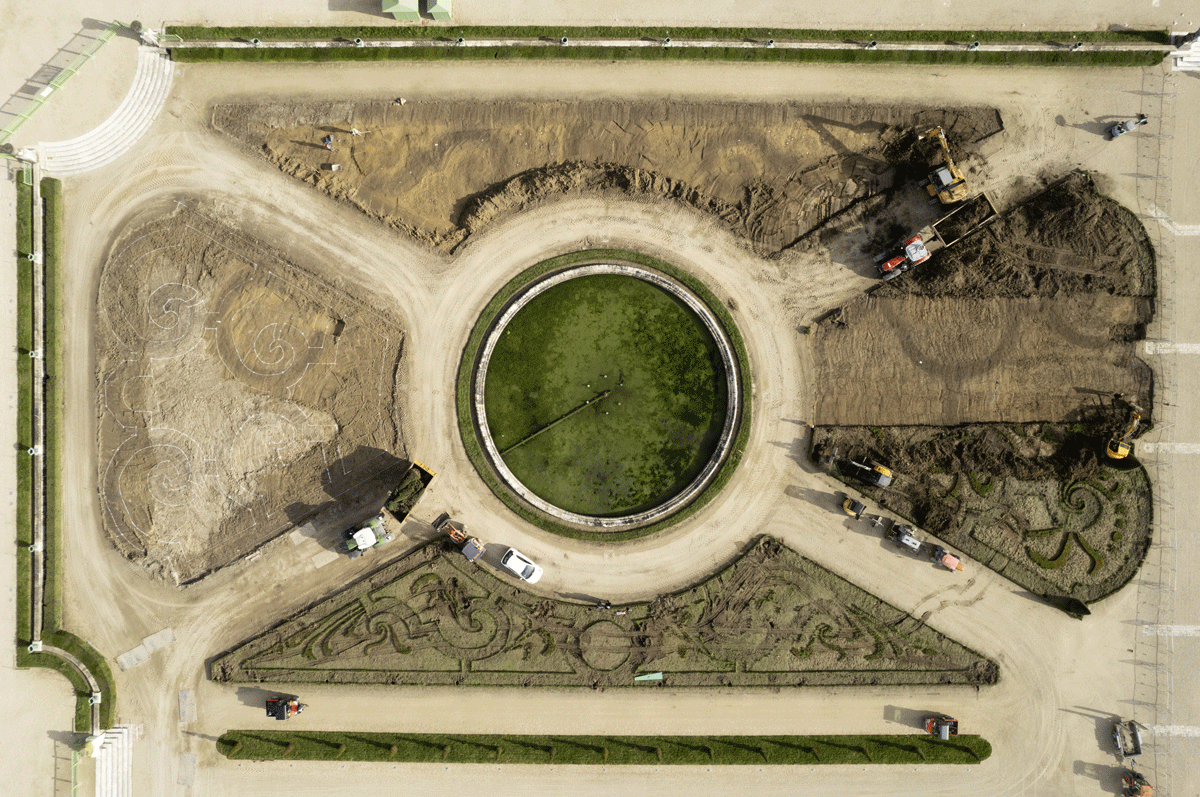
Le parterre du Midi en cours de restauration, au printemps dernier. © EPV / Thomas Garnier
Les fouilles ont également révélé que le parterre n’était pas complètement plat, mais qu’il remontait légèrement côté sud, pour pouvoir encore mieux l’apprécier depuis le château, information indétectable sur les plans ! Au XVIIe siècle, les relevés de jardins en coupe ou en élévation n’existaient pas encore. Ceux-ci nous auraient été bien utiles pour déterminer tous ces motifs en hauteur…
Comment avez-vous pu alors déterminer de manière précise la nature et la forme des végétaux ?
Pour décider de la silhouette des topiaires, nous nous sommes appuyés sur les vues cavalières du jardin et sur des modèles identifiés lors de la restauration du parterre de Latone, non loin de là. Nous avons fixé leur taille à environ sept pieds – soit 2,26 mètres –, ce qui a orienté le choix des ifs. De même, pour les buis, avons-nous dû partir à la recherche d’arbustes adéquats, suffisamment résistants, que nous avons dénichés aux Pays-Bas. Comme vous le savez peut-être, le buis est vulnérable actuellement, notamment face aux attaques de la pyrale, mais c’est bien le seul végétal possible pour obtenir une telle délicatesse de broderie, à partir d’un feuillage suffisamment compact. Quelle intense émotion d’assister à la taille de ces nouveaux plants par les jardiniers du château, et de voir enfin les dessins prendre forme !
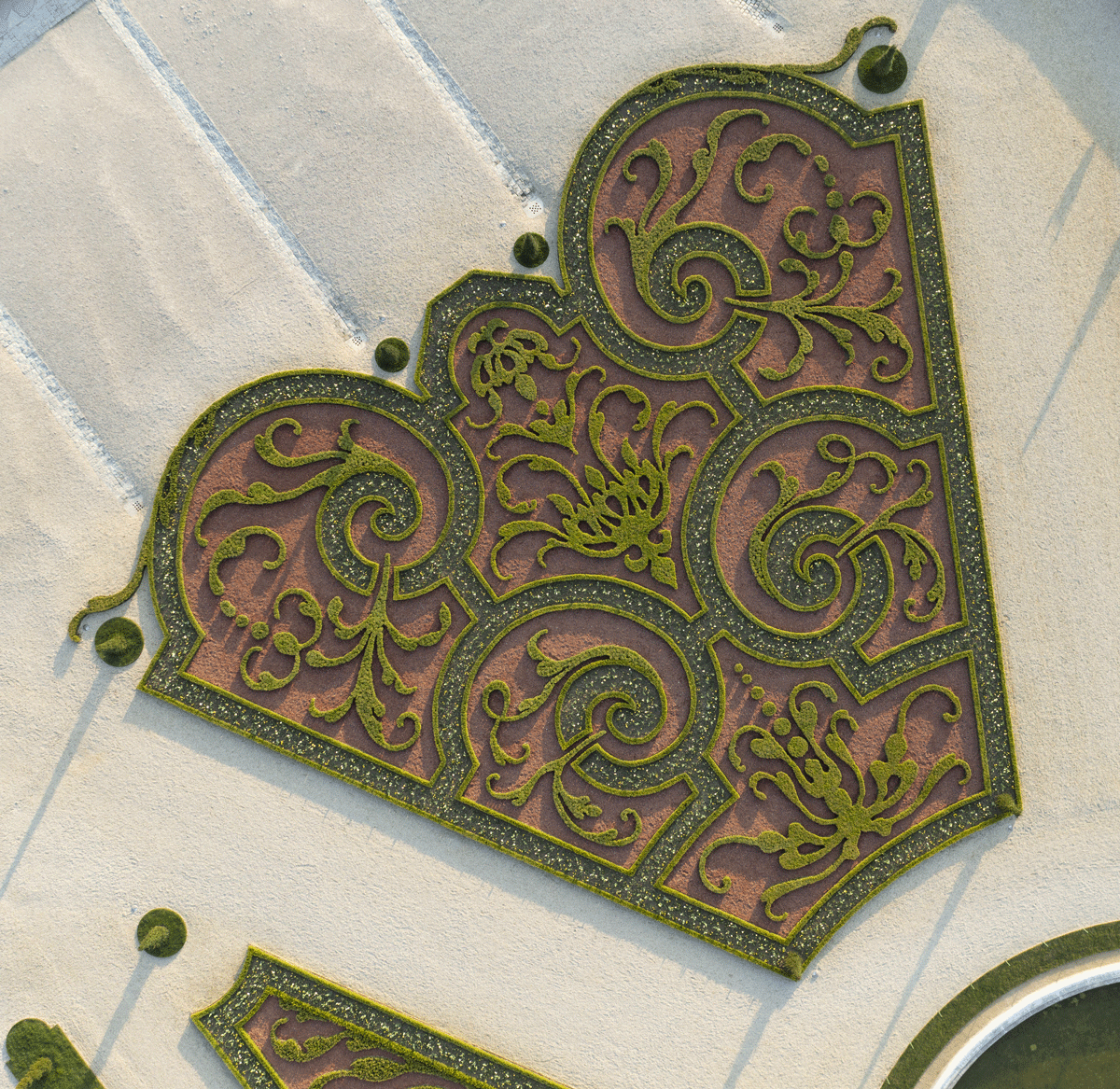
Le parterre du Midi en mars dernier, avec la broderie terminée sur son fond coloré. © EPV / Thomas Garnier
Vous êtes donc parvenu à reconstituer ces motifs, si graciles sur les plans anciens que l’on se demande s’ils ont véritablement existé…
Il s’agit d’une expérience inédite, en effet, à ce degré de finesse, mais n’oublions pas que ces éléments se déploient à une tout autre échelle sur le terrain. Il n’empêche que nous avons tâtonné pour trouver le meilleur moyen de les exécuter. Impossible de se contenter des chiffres pour traduire de tels tracés ! Nous avons essayé d’utiliser des gabarits souples, très compliqués à manipuler. Finalement, nous avons étendu des bâches, traitées comme des pochoirs, découpées au niveau des différents motifs, comme le faisait probablement Le Nôtre avec des draps. Plus de vingt-quatre mille piquets ont été plantés en guise de repères pour suivre et tailler les volutes avec précision. Sans compter l’aide des drones, pour les ajuster sur le terrain ! Comment s’en sortaient nos ancêtres jardiniers, sans Autocad2 et courbés sur leurs buis ?
En tous les cas, l’ensemble du parterre a pris une autre dimension avec ce qui lui manquait depuis longtemps : son fond coloré. Il était d’usage, à l’époque, de remplir les espaces libres de sable noir, jaune ou rouge, ce qui amplifiait les méandres de la broderie. Nous avons choisi de la chamotte3, qui contraste heureusement avec le buis vert sombre et les plates-bandes de gazon, d’un vert plus tendre.

Vue du parterre du Midi en mars dernier, avec la broderie terminée sur son fond coloré. © EPV / Didier Saulnier
Il faut avoir conscience que ce parterre va nécessiter un entretien exigeant, avec une taille précise, un désherbage constant et le ratissage régulier des parties en brique pilée, comme autrefois d’ailleurs, ainsi que l’indiquent les textes anciens. Mais, pour une telle œuvre d’art, que ne ferait-on pas ?
Propos recueillis par Lucie Nicolas-Vullierme,
rédactrice en chef des Carnets de Versailles
1 Végétal (if, buis ou charme) sculpté selon les principes de l’art topiaire, originaire d’Italie.
2 Logiciel de dessin utilisé notamment par les architectes.
3 Argile cuite.
Les travaux de restauration du parterre du Midi ont été réalisés avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine et celui du Département des Yvelines.
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).
Vocabulaire de jardin
Le terme de « broderie » est utilisé dès l’apparition de ce type de parterre, au début du XVIIe siècle, où le buis forme d’élégantes arabesques, directement inspirées des arts décoratifs comme la tapisserie, la dentelle ou la ferronnerie. La trame en est d’abord très serrée, et se détendra par la suite sous forme d’amples volutes.
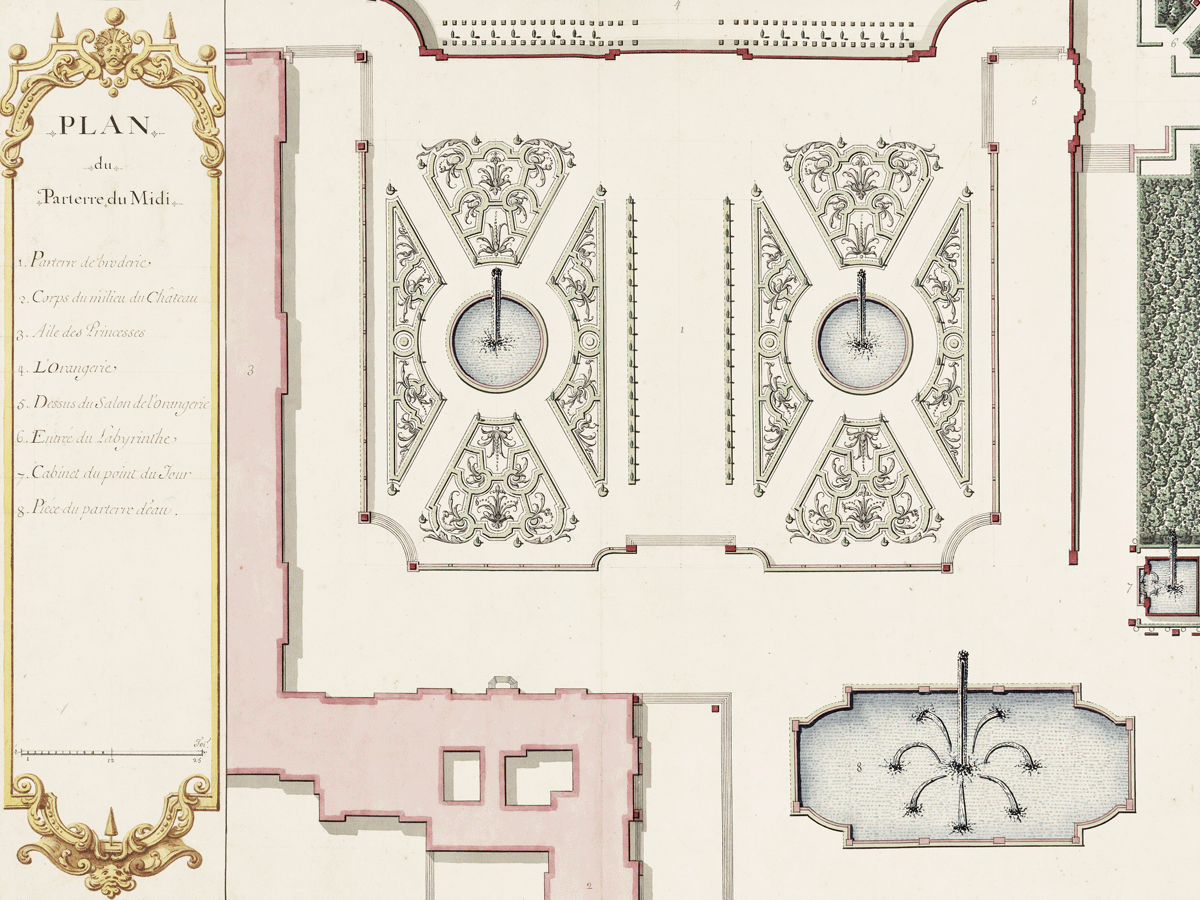
Plan du parterre du Midi, par Jean Chaufourier, 1720, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Paris, GrandPalaisRmn (château de Versailles) / Franck Raux
Versailles compte, dans son histoire, l’un de ces premiers parterres de broderie connus du jardin « à la française », localisé à l’ouest au pied du château et décrit par une planche de Jacques Boyceau, publiée en 1638. Par sa situation sur une terrasse ouverte, celui-ci préfigure les futurs projets de Le Nôtre qui est à l’origine, très certainement, du parterre du Midi, dans les années 1660, où les broderies alternent avec le gazon. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, en effet, les parterres se sont diversifiés, ceux de broderie se déployant selon de multiples formules où le buis est associé au gazon, aux fleurs et aux fonds minéraux colorés. L. N.-V.
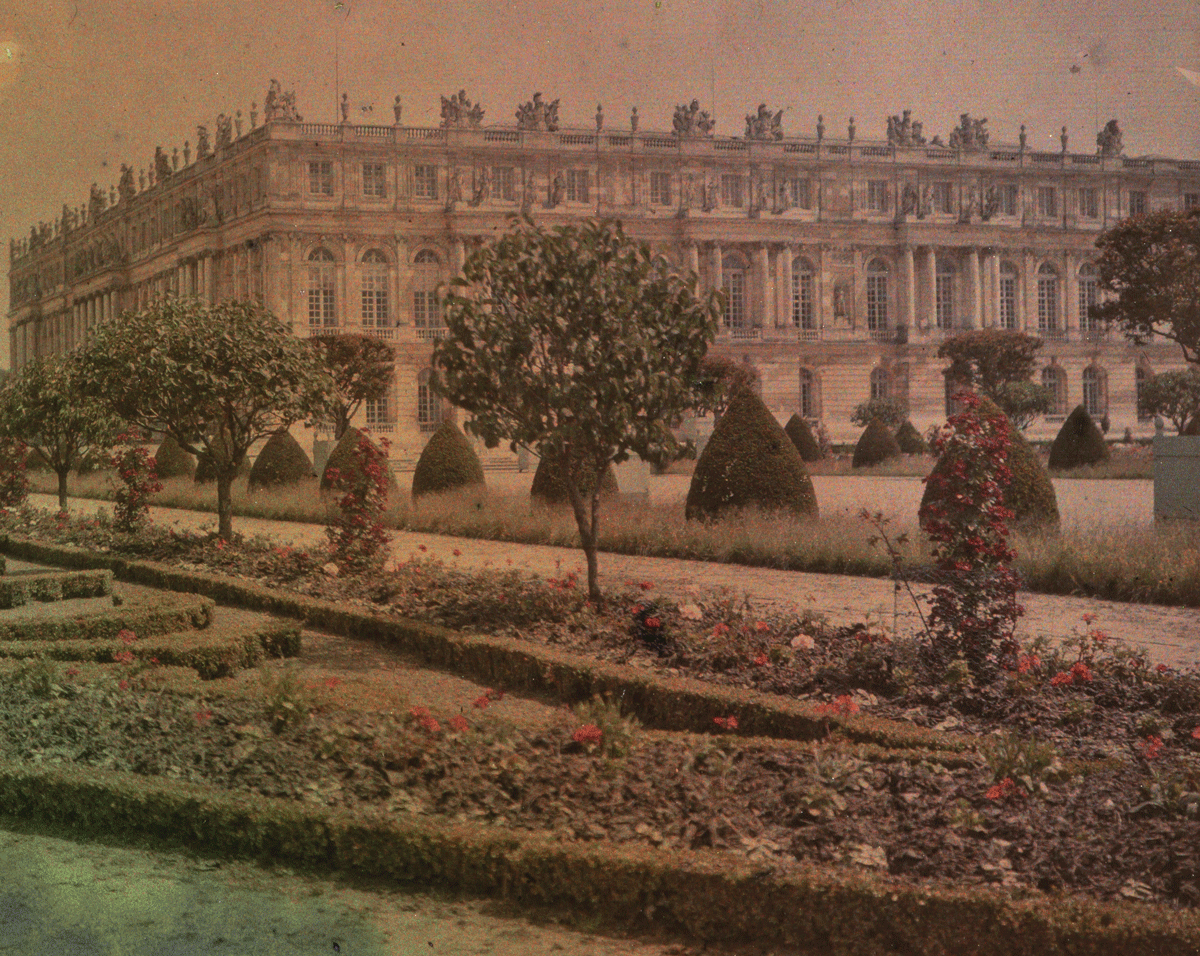
Cliché autochrome sur plaque de verre, par le général Joly, montrant le parterre du Midi en 1913, archives du château de Versailles. © EPV / Christophe Fouin
Question de fleurs
À ses tout débuts, le parterre sud du château est appelé, dans les comptes des Bâtiments du roi, « parterre à fleurs » : il devait alors être orné de fleurs en pot, considérées comme des éléments précieux du jardin. En 1667, le parterre apparaît sous forme de « pièces coupées », larges plates-bandes fleuries qui laisseront ensuite la place à des broderies de buis entourées de rubans de gazon.
En 1753 et 1754, la reine Marie Leszczyńska réclame, comme l’attestent des lettres, « des fleurs dans les parterres au-dessus de l’orangerie au lieu des bandes de gazon qui y sont » : la tentation est forte d’égayer ces lieux, comme l’illustrent aussi les premières autochromes ou une photographie d’Eugène Atget dans laquelle abondent les rosiers et les verveines, ponctués de pois de senteur tuteurés, au début du XXe siècle. Dans les années 1970, ce sont des bégonias roses et rouges qui donnent la tonalité dominante du parterre. Depuis les années 1990, le fleurissement est plus discret, afin de laisser visibles les broderies, avec des plantes basses aux couleurs moins vives. Avec cette restauration, l’on tendra désormais vers un gazon fleuri, comme il était autrefois apprécié en France. L. N.-V.