Les troubles de la Commune ont fait du château de Versailles le siège
du gouvernement durant presque dix ans. L’installation de l’Assemblée, puis celle du Sénat ont marqué durablement les lieux de leur empreinte.
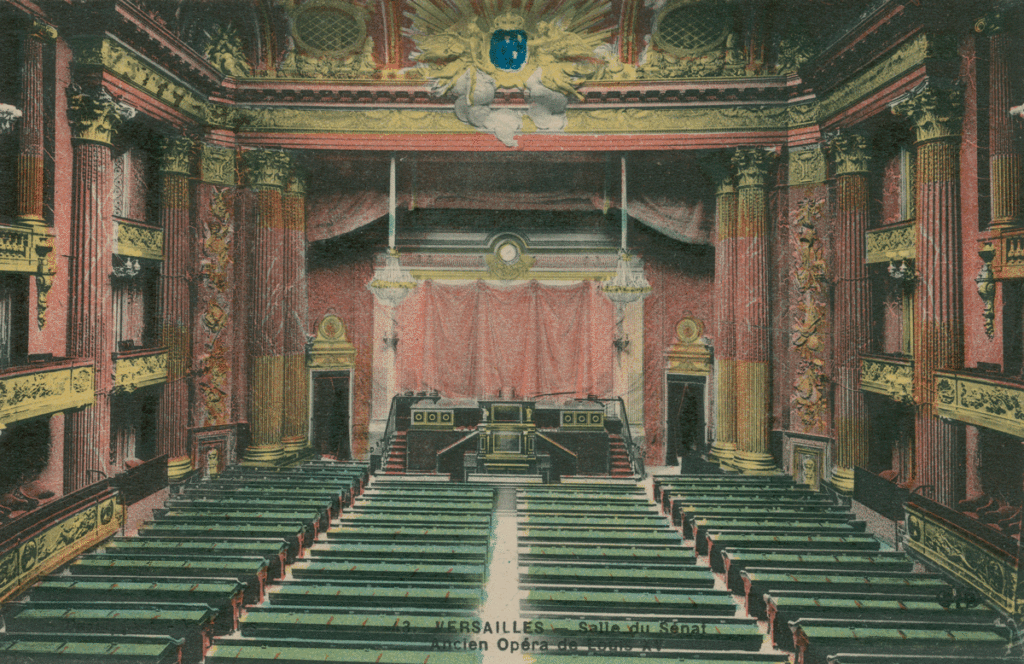
Carte postale montrant l’opéra du château de Versailles transformé en salle du Sénat, 1904-1957, archives du château de Versailles.
© EPV / Christophe Fouin
Alors que la guerre contre la Prusse fait rage, la République est proclamée à Paris, le 4 septembre 1870, après la capitulation de Napoléon III. Le 5 octobre, le roi Guillaume entre dans Versailles et s’installe à la préfecture flambant neuve, qui a l’avantage d’offrir tout le confort moderne. Le 18 janvier 1871, l’Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces.
L’armistice, signé le 28 janvier, prévoit la convocation d’une Assemblée nationale, seule à même de pouvoir ratifier les conditions de la paix ; il faut donc l’élire au plus vite. Le scrutin du 8 février voit une majorité monarchiste l’emporter. Elle confie le pouvoir exécutif à Adolphe Thiers, « en attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France ».
L’Assemblée vient à Versailles
Les préliminaires du traité de paix sont approuvés le 1er mars ; Thiers et ses ministres, réfugiés à Bordeaux, rentrent alors à Paris tandis que les députés, craignant l’agitation populaire qui commence à gagner la capitale, décident de ne pas siéger au Palais-Bourbon. Ils préfèrent s’installer dans une ville à proximité : c’est Versailles, à peine libérée de l’occupation prussienne, qui est choisie.
La demeure de Louis XIV n’est plus une résidence depuis sa transformation en musée en 1837. À la hâte, les architectes Charles Questel et Edmond de Joly transforment l’aile nord du château : des bureaux au rez-de-chaussée, des salles de commissions et conférences au premier étage. Dans le pavillon de Noailles, au centre de l’aile, prennent place la questure et la bibliothèque, non loin de la présidence et du secrétariat général. Le président de l’Assemblée Jules Grévy emménage dans le petit appartement du Roi.
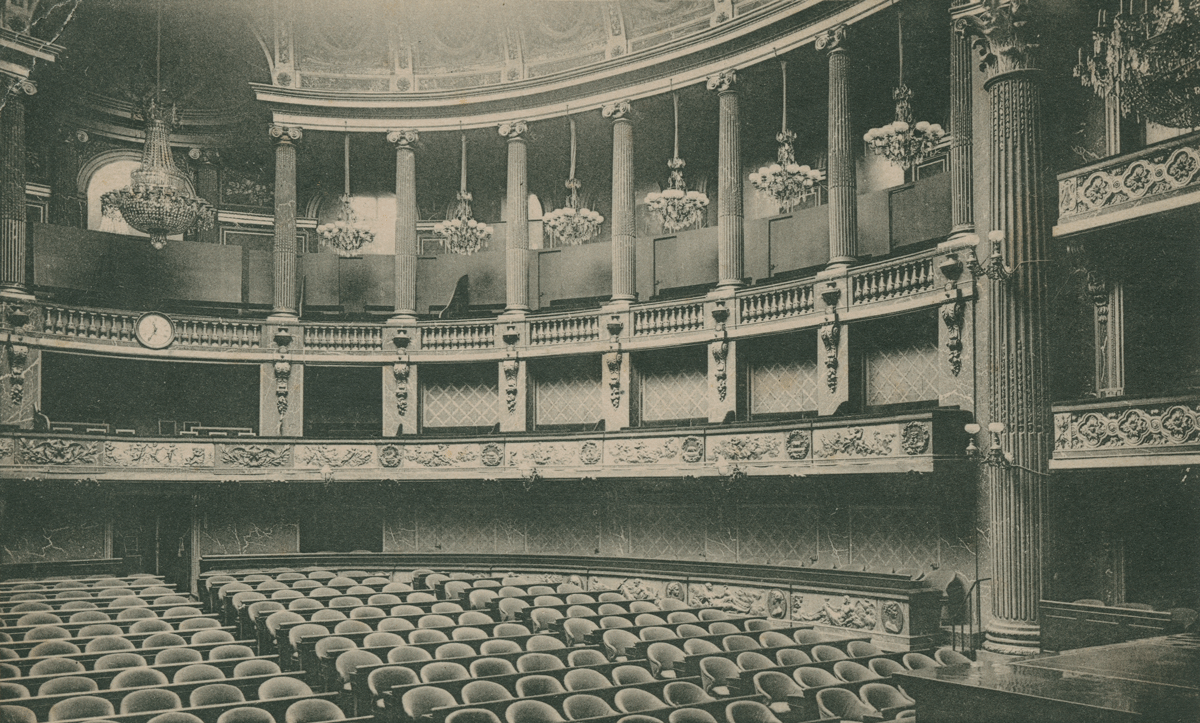
Théâtre du Palais de Versailles (S.-et-O.) – Salle de Séances du Sénat, carte postale par A. Bourdier, 1904-1957, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
© Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin
L’opéra construit par Ange-Jacques Gabriel devient la salle des séances de l’Assemblée : un plancher en pente douce est construit au centre, la fosse est recouverte, et de nouveaux sièges sont confectionnés. Ils ne peuvent accueillir que six cent cinquante-quatre députés, les autres siégeant dans les loges alentour. Au plafond, la toile de Durameau est remplacée par une verrière pour obtenir un éclairage zénithal. On cloisonne la scène, trop profonde, pour y aménager à l’arrière une buvette et une salle des pas perdus.
Un campement gouvernemental
Le 18 mars 1871, la Commune éclate, obligeant le gouvernement à fuir Paris et rejoindre les députés à Versailles. En hâte, les ministres et leurs administrations s’installent dans des campements de fortune, au milieu des appartements royaux : l’Intérieur chez le dauphin et dans la galerie basse, l’Instruction publique dans l’appartement de la Dauphine. Les Affaires étrangères et leur ministre Jules Favre investissent l’appartement de la Reine, les Finances chez Mesdames, le ministre lui-même dormant dans la chambre du Roi. Thiers, quant à lui, se réserve la préfecture, plus confortable. Le Conseil d’État prend ses quartiers dans l’attique du Midi, et les salles Empire du rez-de-chaussée sont attribuées aux Postes ; le courrier est trié au-dessus, dans la galerie des Batailles.
« C’est le début d’une histoire continue, qui voit le Parlement prendre ses quartiers dans l’ancienne demeure royale jusqu’au XXIe siècle. »
Si, après l’écrasement de la Commune, en mai, le gouvernement regagne peu à peu Paris, l’Assemblée nationale choisit de rester à Versailles ; une tentative de retour au Palais-Bourbon est rejetée le 2 février 1872. C’est le début d’une histoire continue, qui voit le Parlement prendre ses quartiers dans l’ancienne demeure royale jusqu’au XXIe siècle. Les députés y construisent peu à peu le régime à coups de compromis, entre tentations monarchiques et divisions républicaines.
L’opéra, lieu de naissance de la république, et la nouvelle salle du Congrès
En 1875, alors que les républicains ont peu à peu gagné en importance à l’Assemblée, le château de Versailles voit consacrer la république comme régime de la nation. L’amendement Wallon, adopté le 30 janvier, puis les lois constitutionnelles de février et juillet sont tous votés au sein de l’opéra de Louis XV. Ils confortent le bicamérisme, le Sénat et la Chambre des députés devant donc cohabiter dans le château.
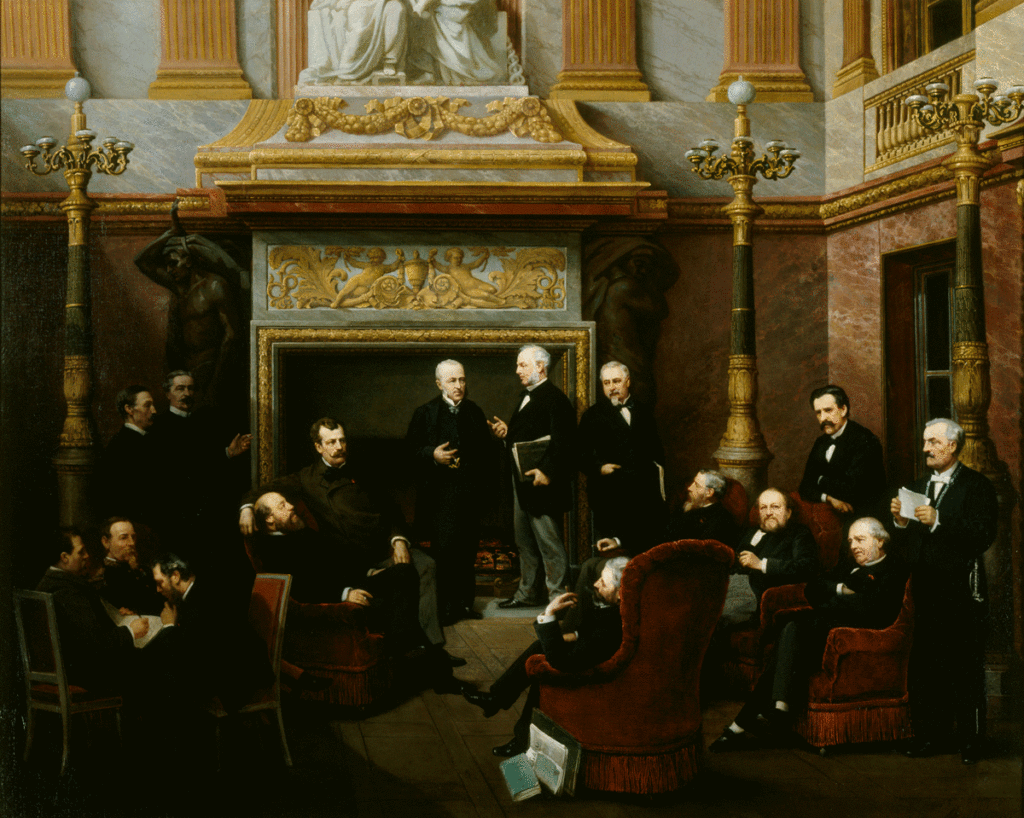
Le Fumoir de l’Assemblée nationale, dans le foyer de l’Opéra royal de Versailles, vers 1875, par Paul-Léon Aclocque, 1876, dépôt du musée Carnavalet – Histoire de Paris au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
Ce tableau a été déposé au château récemment, en décembre 2024, et accroché dans la galerie de l’Histoire.
Aclocque lui-même, qui était député de l’Ariège, y figure, en bas à gauche.
© CC0 Paris Musées / musée Carnavalet
Si le premier s’installe dans l’opéra, on doit prévoir un second espace pour la chambre basse. En six mois, Edmond de Joly construit, au milieu de l’aile du Midi, la salle du Congrès, inaugurée en 1876, destinée à accueillir les séances de la Chambre des députés, mais aussi à recevoir les deux chambres réunies pour élire le président de la République. La dernière construction au sein du château de Versailles, symbole de la monarchie, est en réalité destinée à incarner les institutions de la République.
Le 22 juillet 1879, une loi fixe leur retour à Paris, sans toutefois libérer les locaux versaillais. L’opéra reste affecté jusqu’en 1959 au Sénat… qui ne le réutilisera jamais. L’aile du Midi, ainsi que des locaux dans les ailes des Ministres, restent dévolus au Parlement jusqu’en 2005 et abritent logements, bureaux et salles de réunion. La salle du Congrès sert, jusqu’en 1953, à l’élection du président de la République à quatorze reprises. Depuis 1959, elle est aussi utilisée pour les révisions constitutionnelles et, depuis 2008, pour les adresses présidentielles aux assemblées. Le château de Versailles a vu naître la république et accueille, depuis lors, les événements qui en sont les marqueurs les plus forts.
Fabien Oppermann,
historien
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).

À LIRE
À VOIR
La salle du Congrès et l’appartement du président du Congrès
Horaires : tous les week-ends et jours fériés, en visite libre et en visite guidée,
de 10 h à 18 h 30. La semaine, en visite guidée.
L’aile de Trianon-sous-Bois, au Grand Trianon
Horaires : tous les week-ends, en visite libre et en visite guidée, de 12 h à 18 h 30.
La semaine, en visite guidée.
Billets : la salle du Congrès est accessible avec le billet Passeport, le billet Château,
ainsi que pour les bénéficiaires de la gratuité. Réservation horaire obligatoire.
L’aile de Trianon-sous-Bois est accessible avec le billet Domaine de Trianon.
Le domaine de Versailles est accessible gratuitement et en illimité avec la carte
« 1 an à Versailles ».
AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT
Des visites guidées sur réservation par téléphone au 01 30 83 78 00 ou en ligne.
Une visite théâtralisée en famille.
Un procès fictif pour les étudiants et jeunes adultes.
Un parcours audio à télécharger gratuitement sur l’application mobile.
Deux vidéos sur la République au château et comment celui-ci est devenu un lieu républicain, disponibles sur le site internet et la chaîne YouTube du château de Versailles.
Une programmation spécifique pour les abonnés « 1 an à Versailles ».
POUR EN SAVOIR PLUS
Un colloque sur la République à Versailles, le 4 juin, gratuit et ouvert à tous,
dans la salle du Congrès. Informations et inscriptions sur le site du château.
Un partenariat avec LCP-Assemblée nationale pour les vingt-cinq ans de sa création.
Deux programmes courts multidiffusés sur LCP et disponibles sur lcp.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de LCP narrent l’histoire de ces événements et de ces lieux qui continuent d’abriter les réunions du Congrès.
Pour les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochain, la salle du Congrès et l’appartement du président du Congrès seront ouverts gratuitement ainsi que les salles Empire adjacentes.