Le programme iconographique du plafond de la galerie des Glaces en est
la plus forte illustration : la guerre est partout représentée dans le château de Versailles. L’historien François Pernot, qui en est un spécialiste, vient de publier un livre sur les trente-cinq batailles significatives de l’époque moderne. Nous lui avons demandé d’en choisir six parmi celles menées par l’un des rois les plus belliqueux de l’Ancien Régime qui contribua
à des transformations profondes de l’art militaire.
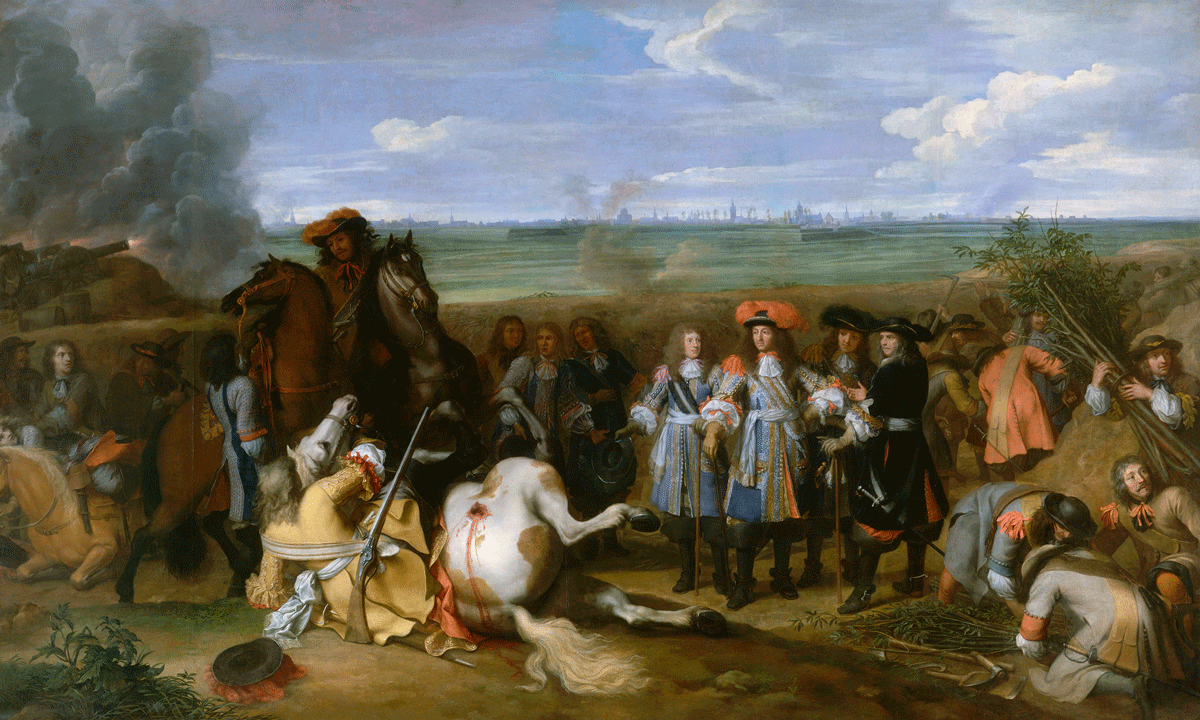
Siège de Douai, 4 juillet 1667, par Baudouin Yvart, d’après Charles Le Brun et Adam-Frans Van der Meulen, 1667-1690, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
Carton de tapisserie de la tenture de L’Histoire du Roi. © Paris, GrandPalaisRmn (château de Versailles) / DR
Ultima ratio regum ([la force / la guerre est] le dernier argument des rois) : cette expression préférée du cardinal de Richelieu, Louis XIV l’a fait inscrire sur la volée de ses canons.
La guerre est bien un instrument au service de ses ambitions politiques et, sous son règne, l’armée devient une institution permanente, financée et contrôlée par l’État.
Louvois, le secrétaire d’État à la Guerre, est une figure clé dans l’organisation, l’intendance et la logistique des troupes qui se modernisent : adoption de l’uniforme, standardisation des armes (comme le mousquet), création d’un corps d’officiers professionnels, renforcement de la discipline, développement de la marine, etc.
Le Roi-Soleil peut alors se lancer dans des campagnes militaires visant à agrandir et sécuriser le royaume. La guerre de Dévolution (1667-1668) et la guerre de Hollande (1672-1678) permettent notamment de consolider les frontières par des conquêtes comme celle de la Franche-Comté.
« La guerre est bien un instrument au service de ses ambitions politiques et, sous son règne, l’armée devient une institution permanente,
financée et contrôlée par l’État. »
« Guerre couverte »
La protection des frontières est également l’œuvre de Vauban, qui construit et améliore des dizaines de forteresses, telles celles de Besançon ou de Lille. L’ingénieur militaire perfectionne aussi l’art du siège afin d’accélérer les prises des places fortes de l’ennemi.
Louis XIV ne pratique pas, en effet, que la « guerre ouverte », il est aussi un maître dans la « guerre couverte ». Ainsi, il mène la politique dite des « Réunions » (1679-1684) à la suite des traités signés à Westphalie (1648) et à Nimègue (1678). S’appuyant sur le flou juridique de ces traités (stipulant que les territoires étaient cédés avec leurs dépendances), le roi de France réunit à la Couronne des dizaines de places fortes frontalières, comme Strasbourg (1681).
Cependant, ces « Réunions » et, plus généralement, la politique hégémonique de Louis XIV en Europe, inquiètent les souverains étrangers : des coalitions se forment et la France se trouve plongée dans des conflits de plus en plus violents, longs et indécis comme la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714).
Des campagnes de destruction systématique dans le cadre d’une stratégie défensive
Ces événements pèsent lourdement sur les finances du royaume et sur le peuple, avec des impôts accrus et des pertes humaines importantes. Les guerres affectent toujours très durement les civils : disettes, pillages et ravages des campagnes. Les destructions que la France mène dans le Palatinat (1688-1689) symbolisent toute la brutalité des stratégies défensives, consistant à interdire à l’ennemi de se ravitailler et d’hiverner sur son territoire. Les batailles du « roi de guerre1 » Louis XIV illustrent l’avènement d’un art militaire moderne reposant sur un État puissant, mais aussi les limites d’une politique ambitieuse.
François Pernot,
professeur des universités en histoire moderne, CY Cergy Paris Université
1 Selon le titre du très beau livre de Joël Cornette, Le Roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1993 (1re éd.).
1. Le siège de Besançon (avril-mai 1674), ou le génie militaire de Vauban
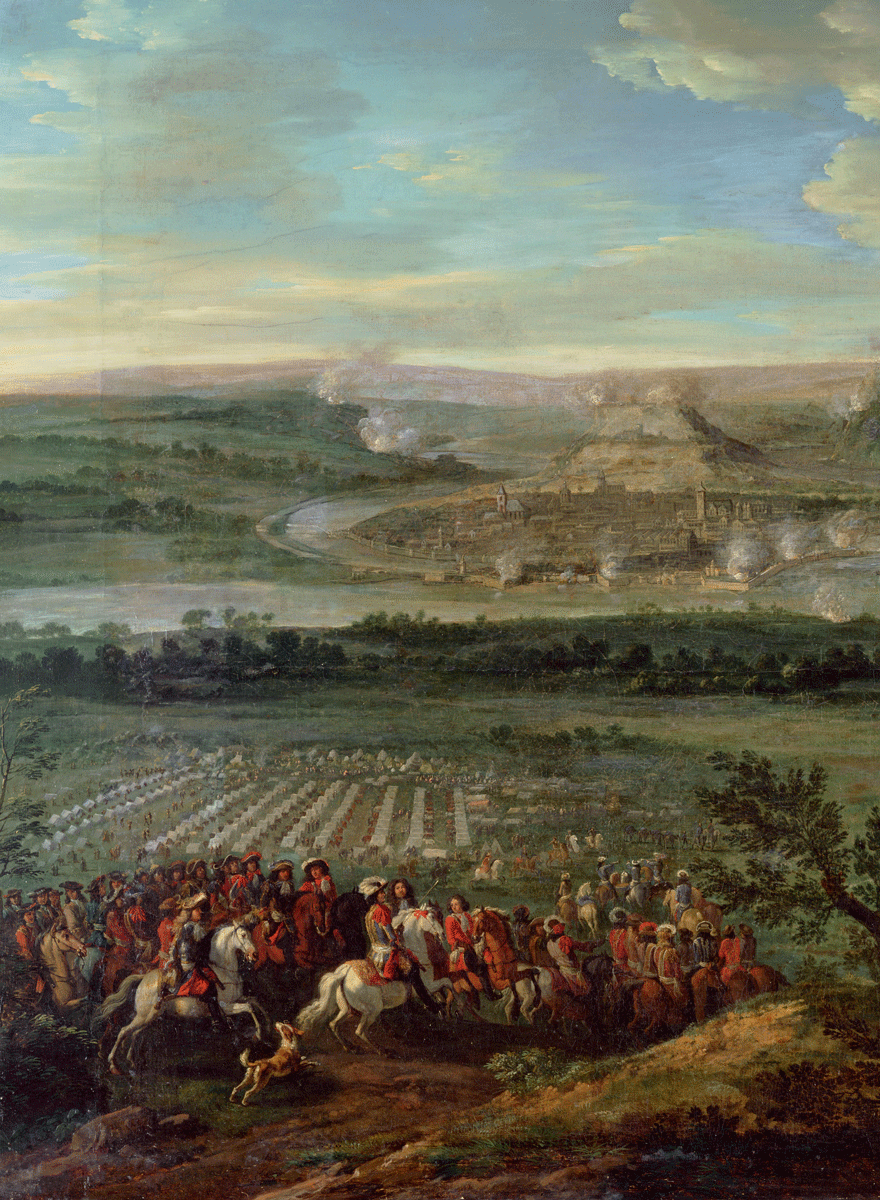
Prise de Besançon, 15 mai 1674 [détail], par l’atelier d’Adam-Frans Van der Meulen, 1676-1700, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Paris, GrandPalaisRmn (château de Versailles) / Daniel Arnaudet
Le siège de Besançon est un épisode phare de la conquête de la Franche-Comté pendant la guerre de Hollande. Après une première occupation française en 1668, la province a été rendue à l’Espagne. Six ans plus tard, Louis XIV décide de la reconquérir pour sécuriser la frontière est de son royaume.
Commandée par le prince de Condé et le marquis de Vauban, l’armée française encercle Besançon, défendue par des soldats comtois, espagnols et impériaux, et met le siège dès le 19 avril 1674, Louis XIV arrivant peu après, le 2 mai. Grâce à une coordination parfaite des attaques et à l’expertise de Vauban en matière d’artillerie, la citadelle, clé de la défense, est prise le 22 mai, après des bombardements et un assaut.
La reddition de Besançon, une des plus puissantes places militaires de la région, marque la fin de la résistance espagnole en Franche-Comté. Par le traité de Nimègue (1678), la province est définitivement rattachée à la France.
2. La bataille de Turckheim (5 janvier 1675), ou la mobilité de l’armée,
gage de la victoire
En pleine guerre de Hollande, la bataille de Turckheim, près de Colmar, oppose les troupes françaises – 30 000 hommes – commandées par le maréchal de Turenne, à une armée austro-brandebourgeoise, dirigée par l’électeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume. À la fin de 1674, celui-ci passe le Rhin avec 30 000 Impériaux et 20 000 Brandebourgeois qui installent leurs quartiers en Alsace.
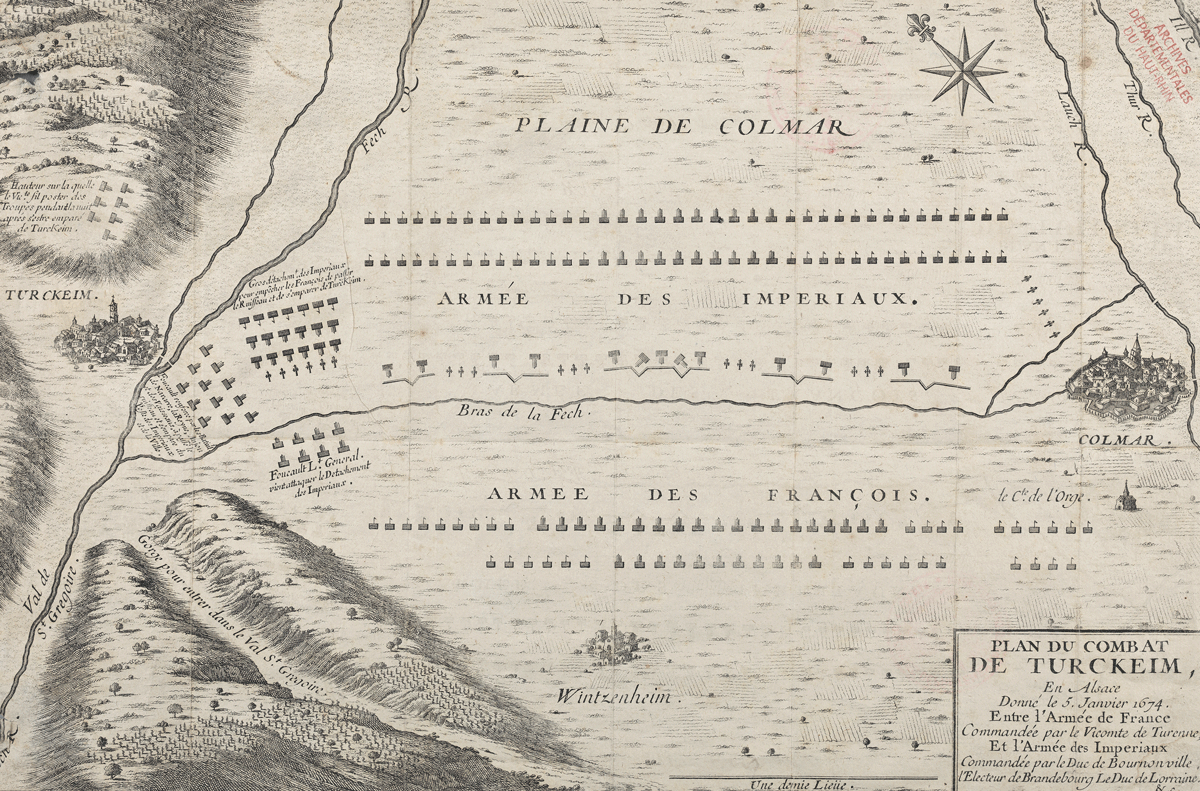
Plan du combat de Turckheim, en Alsace, par Antoine Coquart, XVIIe siècle, Archives d’Alsace, site de Colmar. © Archives d’Alsace, site de Colmar / ESTAMPE/119 © Collectivité européenne d’Alsace, tous droits réservés
Pour surprendre son adversaire, Turenne, dont les troupes se sont repliées vers Saverne, effectue une manœuvre audacieuse : il fait descendre, en un mois, son armée à travers le massif enneigé des Vosges afin de contourner l’ennemi et d’attaquer celui-ci par le sud, à Turckheim. Les Français remportent la victoire, forçant les coalisés à battre en retraite et à repasser le Rhin, et permettant à la France de se maintenir en Alsace. Cette bataille illustre le génie tactique de Turenne, l’importance du terrain et de la mobilité des forces dans la guerre.
3. La bataille de Béveziers (10 juillet 1690), ou les limites du combat naval en « ligne de file »
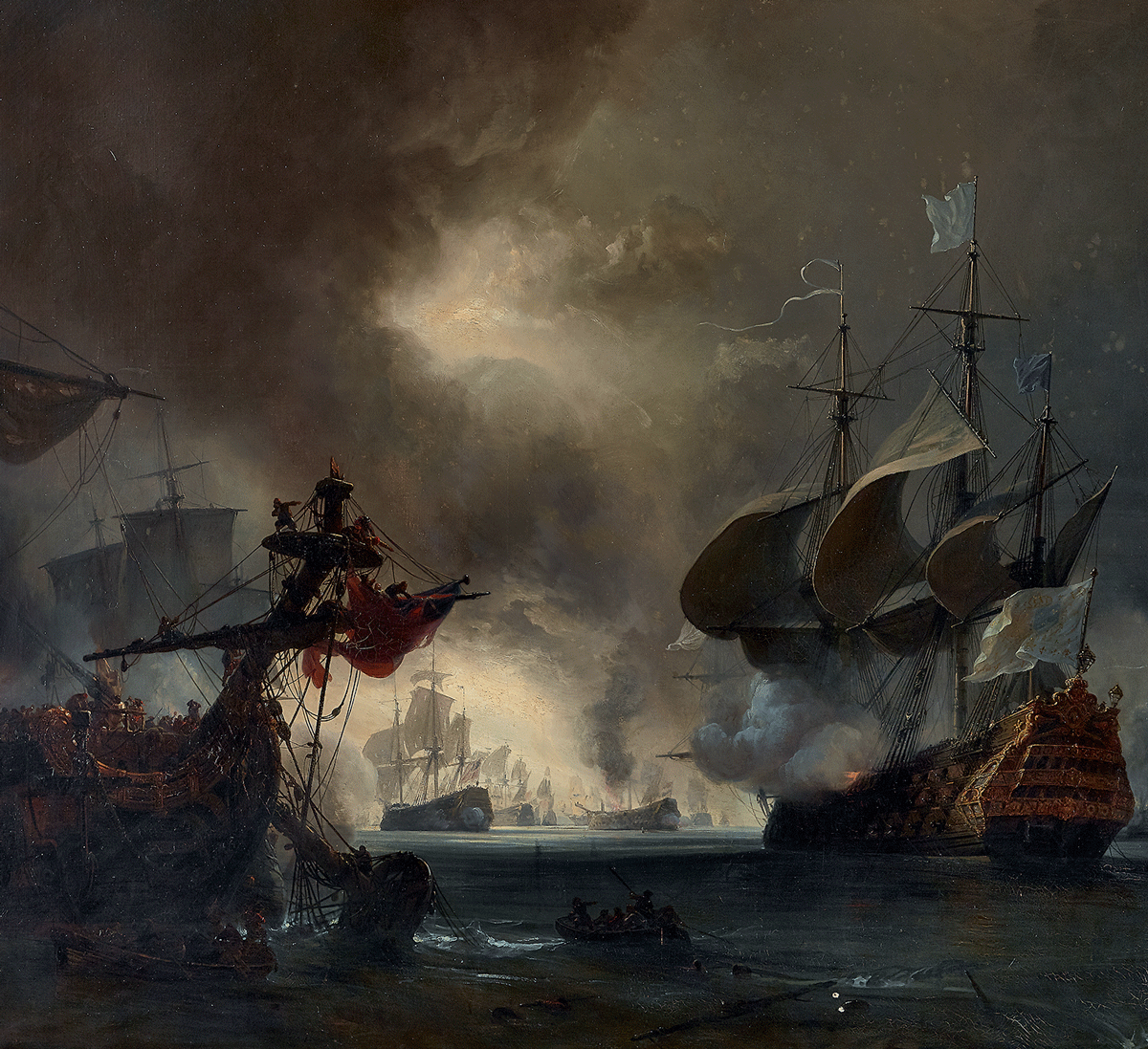
Bataille navale au cap de Béveziers, 10 juillet 1690 [détail], par Jean Antoine Théodore de Gudin, 1839, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © EPV / Christophe Fouin
La bataille navale de Béveziers, aussi appelée bataille du cap Béveziers ou bataille de Beachy Head côté britannique, se déroule pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Elle oppose la flotte française (75 vaisseaux de ligne), dirigée par l’amiral Tourville, à une coalition anglo-hollandaise sous l’amiral Torrington (environ 40 vaisseaux), avec les Hollandais à l’avant-garde (22 vaisseaux) sous Evertsen.
L’objectif, à l’époque, n’est pas de couler les bateaux, mais d’en neutraliser leurs mâtures pour les récupérer. Tourville exploite une erreur de l’avant-garde hollandaise qui a distendu la ligne avec le centre anglais. Il inflige une défaite aux Alliés, qui perdent 17 navires, le reste de l’escadre se trouvant forcé de battre en retraite. Torrington parviendra néanmoins à la ramener jusqu’à la Tamise.
Cette victoire établit ainsi temporairement la suprématie navale française dans la Manche et atteste de la réelle valeur de la marine sous Louis XIV.
4. La bataille de Blenheim (13 août 1704), ou quand l’armée royale française ne paraît plus invincible
La bataille de Höchstädt ou de Blenheim, en Bavière, est un combat déterminant de la guerre de Succession d’Espagne. Elle oppose des forces anglo-autrichiennes (52 000 hommes), menées par le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie, à des troupes franco-bavaroises (55 000 hommes), dirigées par le maréchal de Tallard, le maréchal de Marsin et l’électeur de Bavière.
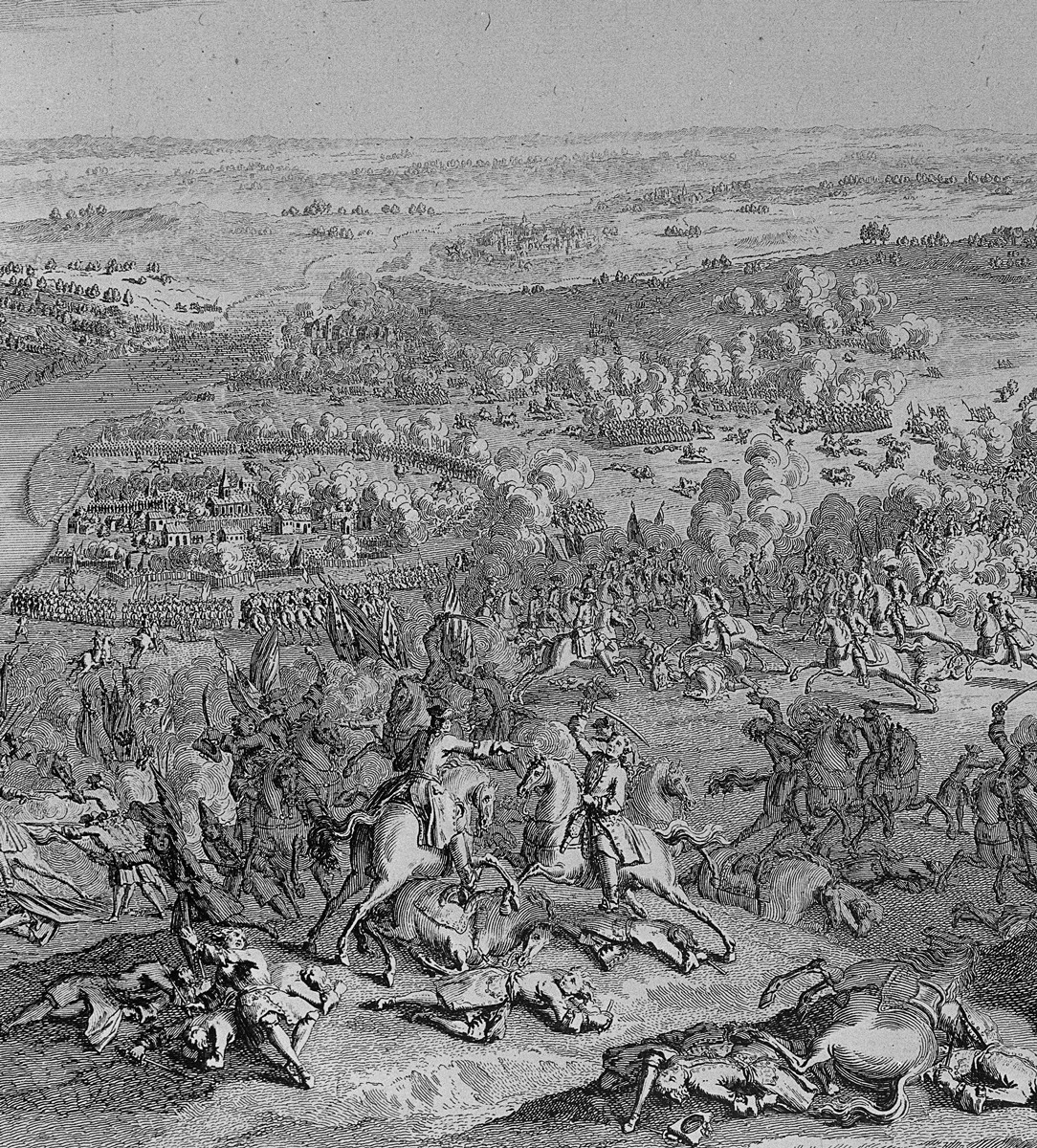
La glorieuse bataille de Blenheim, 13 août 1704 [détail], par Gérard Jean-Baptiste II Scotin le Jeune et Antoine Benoist dit du Cercle, 1735, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Paris, GrandPalaisRmn (château de Versailles) / image GrandPalaisRmn
Cette victoire signe la fin de la réputation d’invincibilité de l’armée française en Europe, place la Bavière sous administration autrichienne et, surtout, ruine les espoirs de Louis XIV de terminer la guerre par une paix rapide.
5. La bataille de Malplaquet (11 septembre 1709), ou une défaite française aux allures de victoire…
La bataille de Malplaquet, dans le Hainaut, est un des affrontements les plus sanglants de la guerre de Succession d’Espagne. Elle oppose l’armée franco-bavaroise, commandée par le maréchal de Villars et le maréchal de Boufflers, à la coalition anglo-hollando-autrichienne, dirigée par le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie.

La bataille de Malplaquet, 11 septembre 1709 [détail], par Louis Laguerre, vers 1713, Londres, National Army Museum. © Londres, National Army Museum / Image reproduite avec l’aimable autorisation du National Army Museum

Louis Hector Duc de Villars, Maréchal Général des Camps et Armées du Roi, par Georg-Friedrich Schmidt, d’après Hyacinthe Rigaud, 1737, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © EPV / DR
6. La bataille de Denain (24 juillet 1712),
ou le « tour de bonneteau » de Villars
Alors que la guerre de Succession d’Espagne s’éternise, les troupes françaises remportent une victoire décisive à Denain. Après des années de revers, elles semblaient toujours surclassées par celles de l’alliance austro-anglo-hollandaise. Le maréchal de Villars imagine alors une stratégie audacieuse pour renverser la situation. Il ordonne à ses troupes, qui stationnent au sud du Cateau-Cambrésis, d’effectuer un mouvement de diversion vers le sud-est, sur Landrecies, pour que son adversaire, le prince Eugène de Savoie, allège son dispositif sur Denain. Dans le même temps, il fait marcher le gros de son armée, de nuit et dans la plus grande discrétion, vers le nord-ouest où Denain est tenu par les Hollandais, sous les ordres du général Albermarle.

Bataille de Denain, 24 juillet 1712, par Jean Alaux, 1839, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Paris, GrandPalaisRmn (château de Versailles) / image GrandPalaisRmn
En quelques heures, les Français investissent la ville, font des milliers de prisonniers et s’emparent de ravitaillement. Cette victoire modifie le cours de la guerre. Le génie tactique de Villars, qui a su attaquer là où on ne l’attendait pas, sauve la France d’une invasion et permet à Louis XIV de négocier honorablement la paix d’Utrecht (1713).
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).
À LIRE
François Pernot, Guerres et batailles de l’époque moderne. De Marignan à Yorktown, Paris, ministère des Armées / éd. Perrin, 2024.