Les liens entre la France et l’Inde sont très documentés à partir du XVIIIe siècle, grâce notamment au développement commercial avec Pondichéry. C’est moins le cas pour les relations qui s’établirent sous Louis XIV, alors que les richesses, les savoir-faire et la pluralité de la société de l’Empire moghol forçaient l’admiration. Cette fascination émergea d’un salon méconnu, celui de Madame de La Sablière.

Portrait de Madame de La Sablière [détail], par l’atelier des frères Beaubrun, XVIIe siècle, Bussy-le-Grand, château de Bussy-Rabutin.
Depuis plus de trois cent cinquante ans, Versailles est source de conversations. Il l’était autrefois à la Cour, mais aussi en dehors, notamment dans les « ruelles », nom que portaient alors les salons littéraires1. Des écrits du Grand Siècle, souvent sous forme de dialogues, nous font entendre ce que le château et ses jardins inspiraient à leurs visiteurs divers. Si le nom de Louis XIV était sur toutes les lèvres, les traces de ces discussions laissées dans les textes nous apprennent qu’elles étaient alimentées aussi par d’autres figures, voire d’autres contrées. Avec le personnage d’une « belle étrangère », dans La Promenade de Versailles, la célèbre salonnière Madeleine de Scudéry introduit ces autres mondes dont on parlait également dans les ruelles, organisées par les femmes à distance des académies royales. C’est dans ce climat intellectuel singulier, entretenu par mondains et savants, hommes et femmes fréquentant conjointement les salons, que la rencontre de la France et de l’Inde a pu avoir lieu, au milieu du XVIIe siècle, ne ressemblant à celle d’aucun autre pays européen.
Un intérêt suscité par le voyage de François Bernier
À l’époque où Madeleine de Scudéry rédige son texte, l’Inde et son Empire moghol occupent les esprits. En témoignent les œuvres les plus connues du XVIIe siècle : La Fontaine dit s’inspirer de « Pilpay, sage indien » pour son deuxième volume des Fables ; Madame de La Fayette, dans son célèbre roman, met en scène la princesse de Clèves faisant des nœuds
« autour d’une canne des Indes, fort extraordinaire » ; Madame de Sévigné fait référence à la nouvelle mode des « indiennes ». Ces amis se côtoient à Versailles, mais se réunissent également dans la ruelle de Marguerite de La Sablière (1640-1693). C’est la fréquentation de son salon, le plus érudit et hétéroclite de l’époque, qui explique leur connaissance partagée de l’Inde et les références qu’ils en font dans leurs œuvres.
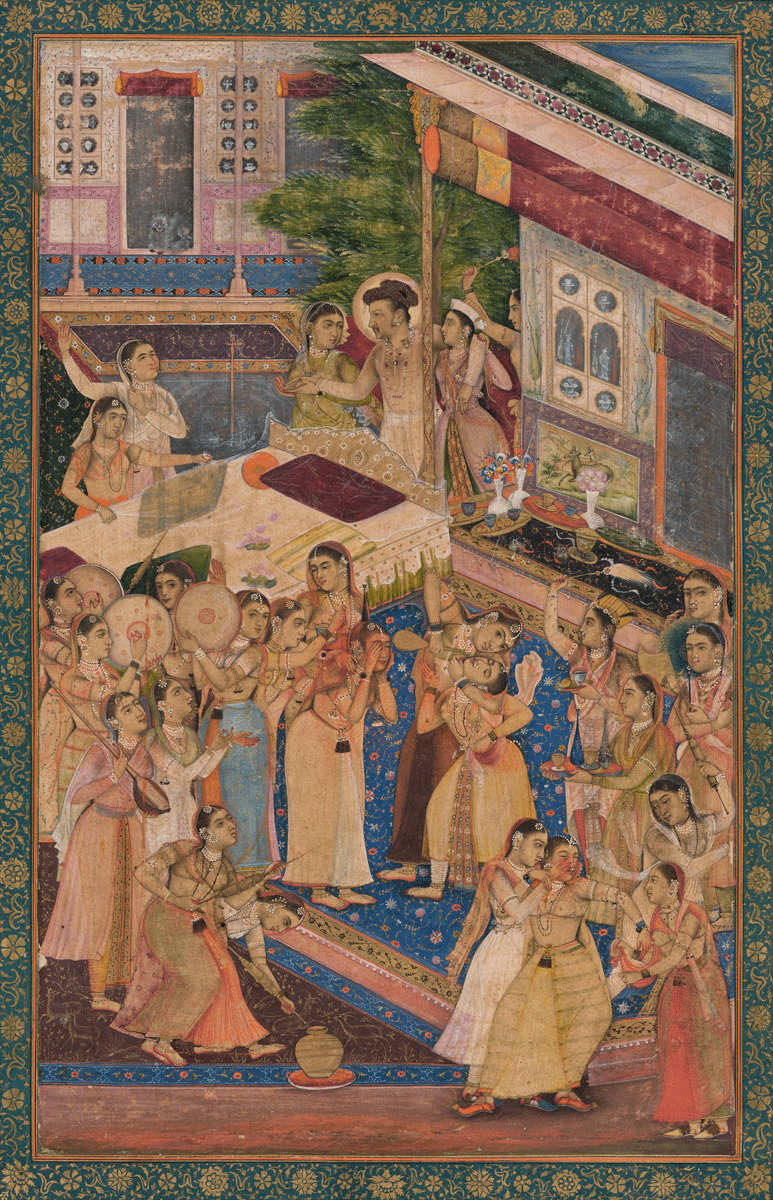
Jahangir célèbre la fête hindoue de Holi, anonyme, vers 1635, Dublin, Chester Beatty Library. © Dublin, Chester Beatty Library / Chester Beatty, Dublin, CC BY- 4.0
En effet, Madame de La Sablière accueille chez elle François Bernier (1620-1688) dès son retour de l’Inde, où il a passé dix ans, d’abord dans l’entourage de l’empereur Shah Jahan, qui avait fait construire le Taj Mahal (1632-1648), puis à la cour de son fils, Aurangzeb, qui l’avait renversé avant de prendre le pouvoir en 16582. À son retour, surnommé « le Mogol » par ses contemporains, Bernier fait le récit de ses expériences et partage ses connaissances sur l’Hindoustan, avant de publier plusieurs volumes en 1670 et 1671. Ses écrits deviendront les plus estimés sur le sujet pendant des siècles grâce à la position inédite de leur auteur. Philosophe et médecin, Bernier est un voyageur insolite pour son temps, car il est parti en Inde de sa propre initiative. Dans ses récits, il dépeint cette culture lointaine comme une source d’inspiration pour la France, et non comme un royaume à conquérir. Ses textes se distinguent de ceux des marchands, des missionnaires et des envoyés politiques. Ils s’adressent à un public varié, composé de savants, d’érudits, d’académiciens et de mondains, dont le salon de Madame de La Sablière offre un bel exemple : ils y furent lus et abondamment commentés. Ces conversations – et pas seulement les textes publiés – alimentèrent durablement l’imaginaire collectif.
Des femmes et des palais
Afin de susciter ces conversations, Bernier choisit d’inclure des aspects qui peuvent intéresser tout particulièrement ses contemporains. Ainsi accorde-t-il une attention particulière aux femmes qui, sous Louis XIV, jouaient un rôle exceptionnel dans la vie culturelle. Écrivains, elles étaient aussi des arbitres du goût et il n’était pas rare qu’elles jouent un rôle politique. Ainsi Henriette d’Angleterre, la belle-sœur du roi, a-t-elle servi de lien entre la France et l’Angleterre. Il en allait de même des femmes indiennes qui, dans les écrits de Bernier, défient les stéréotypes traditionnels. Est évoquée la légendaire Nur Jahan (1577-1645), impératrice et régente de l’Empire moghol au début du siècle, et sont mises en lumière les activités de Jahanara et de Raushanara, sœurs de l’empereur Aurangzeb.
Nourris de ces discussions sur l’Inde auxquelles ils avaient pris part dans les salons, les visiteurs du domaine de Versailles durent être frappés par les similitudes avec la cour moghole. Les textes de Bernier sont remplis de descriptions d’édifices et de jardins somptueux. Les chandeliers de cristal, reflétés à l’infini dans les glaces de la Grande Galerie, et les bosquets animés par les fontaines n’illustrent pas seulement la puissance du Roi-Soleil, ils font aussi écho à celle des empereurs moghols. Leurs palais comportaient des salles appelées « shish mahals » dont les murs et les plafonds étaient couverts de miroirs si bien qu’une seule bougie suffisait à en éclairer l’ensemble. L’eau alimentait des fontaines et participait aussi à d’ingénieux systèmes de climatisation. Les deux royaumes, à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, avaient la même volonté d’éblouir par l’art et de dominer la nature.
« Nourris de ces discussions sur l’Inde auxquelles ils avaient pris part dans les salons, les visiteurs du domaine de Versailles durent
être frappés par les similitudes avec la cour moghole. »
Fureur pour l’Inde
Bernier associe les adjectifs « royal » et « auguste » au nom de l’empereur moghol qu’il ne qualifie jamais, remarquons-le, de « despote ». À l’inverse, lorsqu’ils contemplaient le Roi-Soleil couvert de diamants, les courtisans pensaient forcément à l’Inde, la seule source de ces joyaux au XVIIe siècle. Pour asseoir son pouvoir, Louis XIV s’en était procuré grâce à Jean-Baptiste Tavernier, qui séjournait en Inde en même temps que Bernier.
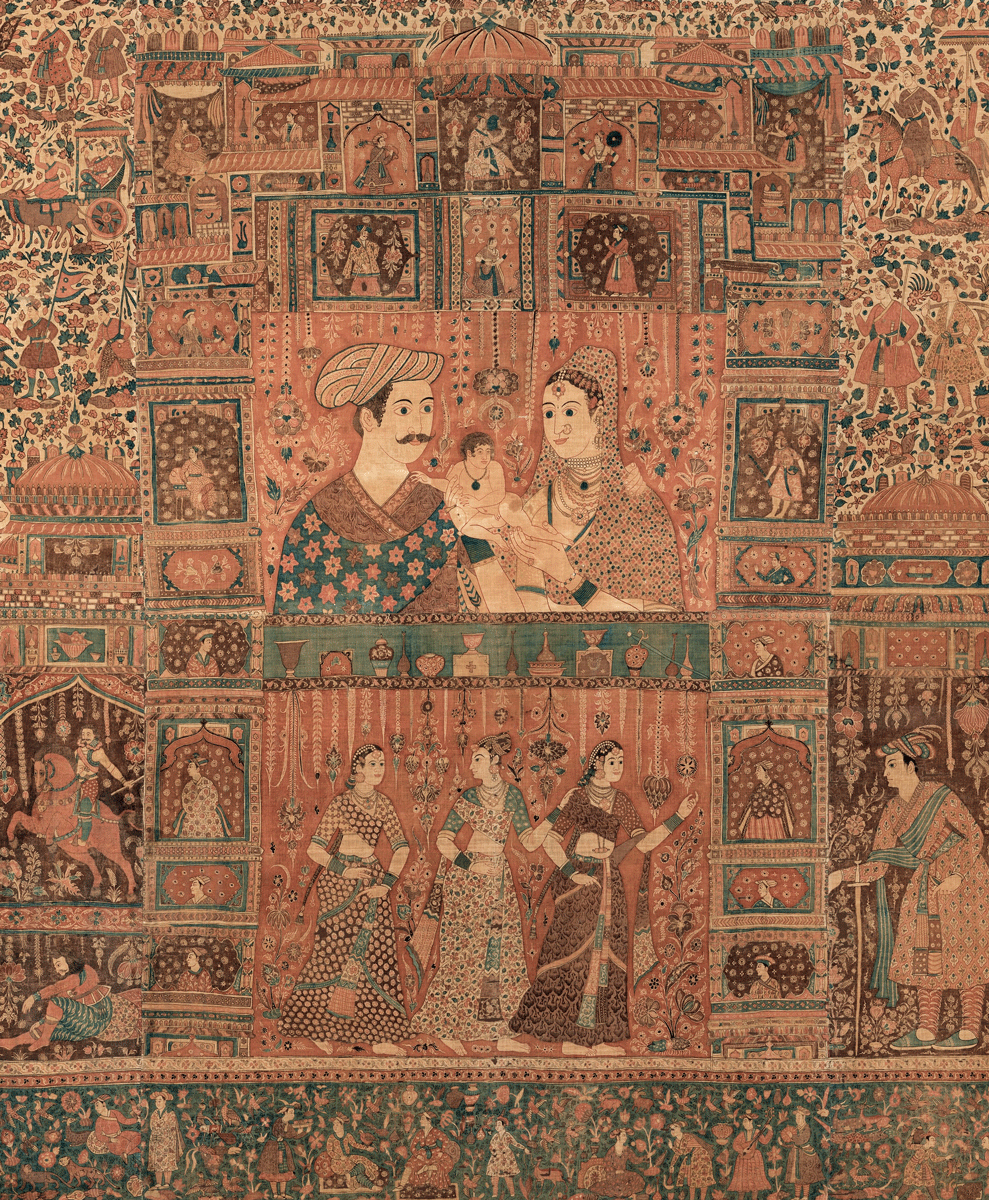
Kalamkari avec personnages représentés dans les éléments architecturaux [détail], anonyme, vers 1640-1650, New York, Metropolitan Museum of Art.
L’attraction de l’Empire moghol sur la France du Grand Siècle était particulièrement sensible dans la mode. On s’habillait et on s’entourait de toiles peintes, les fameuses « indiennes », qui n’avaient pas leur équivalent en Europe, comme en témoigne Le Mercure galant. Afin de contrer cet engouement, Louis XIV bannit, en 1686, l’importation de ces cotonnades et, peu après, bannit également l’importation des simples cotons blancs dont l’industrie textile française se servait pour imiter les indiennes. Malgré de nombreux édits, la fascination pour l’Inde persista, soutenue surtout par les femmes. « La mode des toiles peintes a prévalu sur toute règle et toute raison ; les plus grandes dames, et les autres en imitant leur exemple, les portent publiquement et partout impunément, avec le plus scandaleux mépris public pour les défenses contre elles », raconte Saint-Simon3. En 1709, un certain M. Ravat se plaint au contrôleur général : « Aujourd’hui, le sexe n’est habillé que de furies… le nom de furie n’a été donné à ces tissus qu’en raison de la fureur que toutes les dames indistinctement ont eue à s’en vêtir en dépit des interdictions4. »
Les femmes ont donc joué, dans l’attrait pour l’Inde, un rôle déterminant à tous points de vue… Ressusciter les textes, rappeler les voix de celles et ceux qui ont été contraints au silence par les historiens, prendre en compte les salons et reconnaître leur influence sur la Grande Histoire, tout cela nous permet d’entendre d’autres conversations. Le Grand Siècle ne nous a pas encore livré tous ses secrets !
Faith E. Beasley,
professeur de littérature et d’histoire françaises à l’Université de Dartmouth, États-Unis
1 Le terme vient de l’alcôve attenante au lit, espace le long du mur, dans la chambre à coucher de certaines dames de qualité qui y accueillaient leur salon littéraire.
2 François Bernier a séjourné en Inde de 1659 à 1669.
3 Jennifer M. Jones, Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France, New York, Bloomsbury, 2004, p. 32.
4 Félicia Gottmann, « The French State and the Retail and Consumption of Asian Cottons 1686–1759 », dans M. Berg, F. Gottmann, H. Hodacs et C. Nierstrasz (éd.), Goods from the East, 1600–1800 : Trading Eurasia, Londres, Palgrave Macmillan, 2015, p. 252-253.
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).
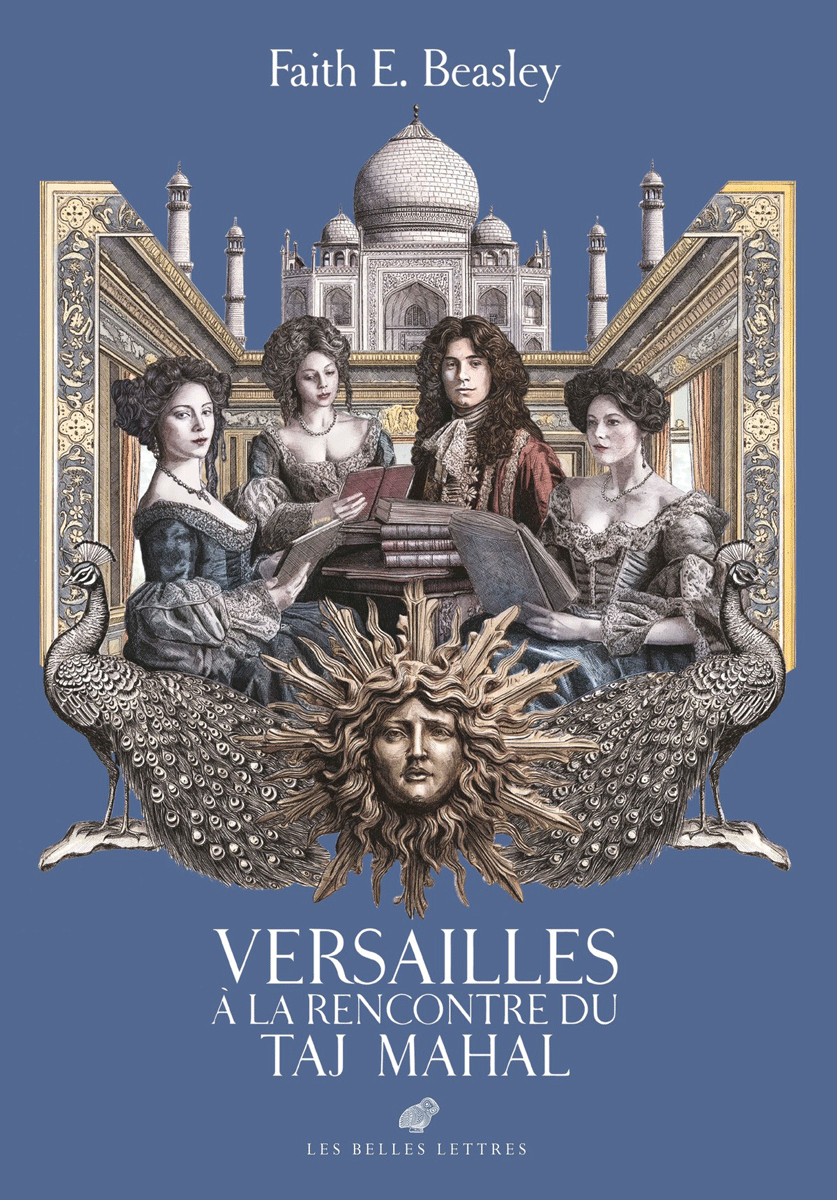
À LIRE