Comment remeubler le château exactement comme il se présentait
en 1789, après les ventes révolutionnaires et tant de transformations
des lieux ? Des objets analogues, par leur fonction, leur qualité, voire
leur prestige, contribuent grandement à l’appréhension des espaces.
Laurent Salomé, directeur du musée, s’est livré à l’exercice délicat
d’en vanter les mérites.
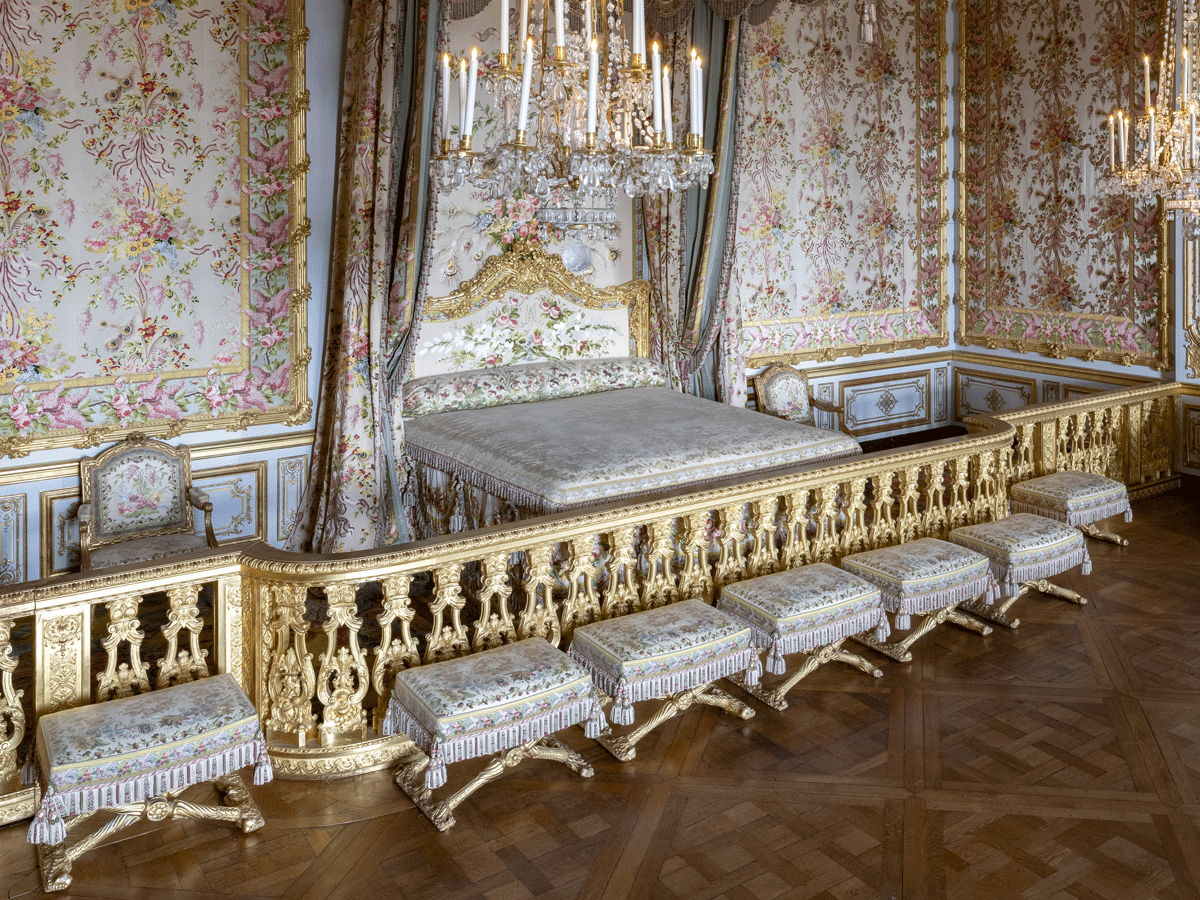
La chambre de la Reine avec, au premier plan, la série de ployants. Quatre d’entre eux sont précisément ceux qui s’y trouvaient autrefois. D’autres appartenaient à la comtesse d’Artois. ©EPV / Thomas Garnier
Dans la chambre du grand appartement de la Reine, le nombre de ployants disposés devant le balustre1 est presque conforme à l’Étiquette. Il approche de l’état du château à la veille de la Révolution, ce fameux « état du 6 octobre » qui guide la politique de remeublement du musée. Il s’agit bien de sièges livrés pour Versailles, à la fois sobres et opulents, aimablement antiquisants, témoins du vrai goût royal. Toutefois, une partie seulement de ces ployants étaient autrefois dans la chambre de la Reine, revenus à leur place grâce… à un dépôt du château de Compiègne qui les avait acquis en 1960 !
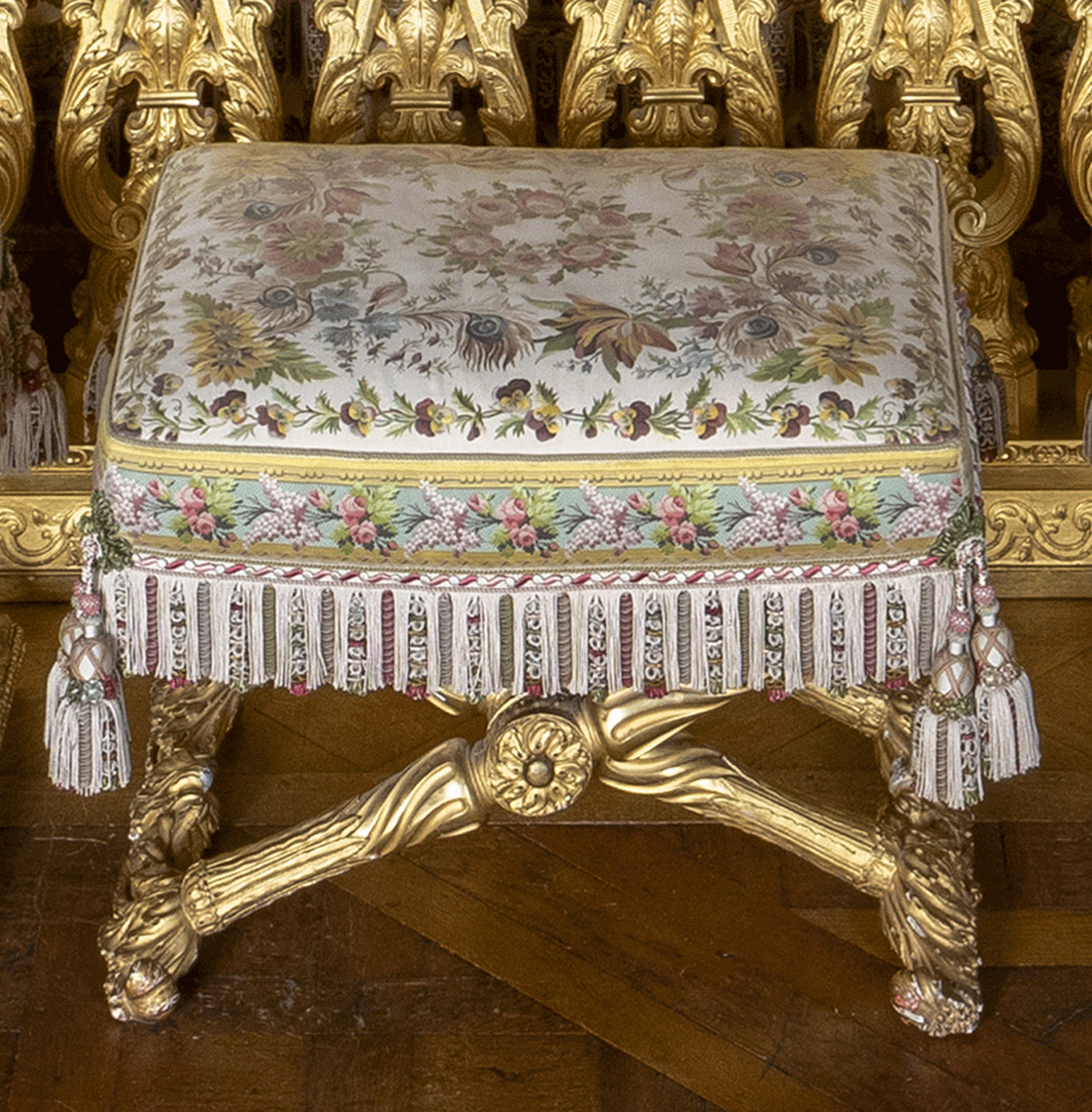
Vue sur l’un des ployants situés dans la chambre de la Reine. ©EPV / Thomas Garnier
Il n’y a guère d’espoir de réunir la série complète : les sièges de ce type ont été éparpillés de par le monde depuis deux siècles, peu à peu dépouillés de leur identité et perdus de vue. Il est déjà fort heureux d’en avoir quatre. Mais Marie-Antoinette avait deux belles-sœurs, les deux princesses de Savoie, mariées respectivement au comte de Provence et au comte d’Artois. Et l’ameublement de leurs appartements versaillais était très comparable à celui de la reine : même goût, même luxe parfois, en tout cas, mêmes fournisseurs. Or, plusieurs ployants livrés pour la chambre de la comtesse d’Artois sont entrés dans les collections du château, à partir de 1966 et jusqu’à une date récente, une paire ayant été acquise à l’occasion de la vente de la collection de Bernard Tapie. Ces sièges diffèrent légèrement de ceux de la reine, mais s’avèrent tout aussi beaux, issus du même atelier et répondant à la même fonction essentielle dans une chambre d’apparat. L’appartement de la princesse dans l’aile du Midi n’existant plus, voilà une parfaite équivalence qui participe du succès de la chambre de la Reine.
Un canapé, une table chiffonnière et une pendule

Table chiffonnière de la comtesse de Provence qui a été placée dans le boudoir de Marie-Antoinette.
© EPV / Christophe Fouin
C’est la double vertu de ces équivalences qui demeurent un moyen primordial dans l’effort de restitution scientifique du palais de l’Ancien Régime : d’une part, des objets provenant d’appartements détruits peuvent rejoindre nos collections, être donc sauvés et mis à la disposition du public ; d’autre part, ces objets viennent combler les lacunes dans les appartements existant encore, permettant d’en retrouver à la fois la logique fonctionnelle et la splendeur.
La chambre de la Reine restait un peu vide ? Quelle chance, il subsistait le canapé de celle, disparue, de la comtesse de Provence, d’une qualité parfaitement royale ! Le Mobilier national accepta de le déposer en 1991, et le tour était joué ! Par ailleurs, la comtesse de Provence aimait autant que Marie-Antoinette les meubles à plaques de porcelaine. Sa table chiffonnière semée de roses et de barbeaux, acquise en 2022, a trouvé un écrin idéal dans le boudoir de la Reine, au deuxième étage. Quant au comte d’Artois, dont le mythique cabinet turc se situait à l’emplacement de la galerie des Batailles, il a fourni, avec la pendule aux sultanes, un objet digne d’orner la cheminée du salon des Nobles…
Des objets retrouvés qui font revivre le château
La transformation du château en musée historique sous Louis-Philippe a fait disparaître une multitude d’appartements dont les meubles, vendus à la Révolution, ressurgissent régulièrement. Par équivalence, ces objets retrouvés permettent de faire exister les appartements restants : Roi, Reine, Dauphin, Dauphine, Mesdames, Pompadour, Du Barry, Maurepas, Tourzel… Il est toujours préférable, dans les acquisitions, de privilégier les objets provenant d’un ancien logement de Versailles, fût-il celui de l’aumônier des écuries. Ainsi, chez le dauphin, à défaut de conserver ses propres meubles, on est content de disposer de ceux de son gouverneur, le duc d’Harcourt, et de son épouse, qui logeaient à côté.
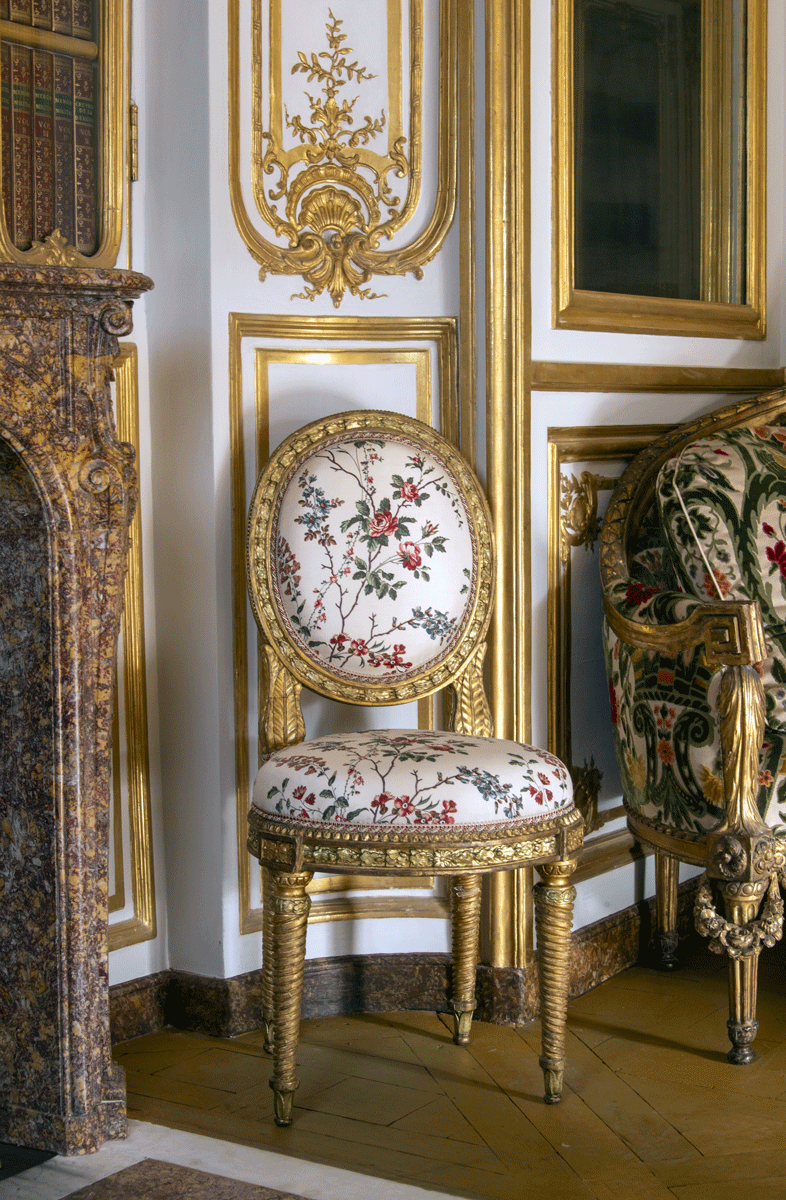
L’une des chaises à médaillon de la donation de la duchesse de Windsor installée dans la bibliothèque de madame Du Barry. ©EPV / Didier Saulnier
Parfois, ce sont des dons et legs anciens, acceptés avec plus de facilité que nous ne le ferions aujourd’hui, dont l’usage peut rester longtemps un casse-tête, jusqu’à ce que l’objet trouve sa place et, du même coup, sa magie : ainsi deux petites chaises à dossier en médaillon faisant partie de la donation de la duchesse de Windsor, après des décennies de purgatoire, rayonnent aujourd’hui de tout leur charme dans la bibliothèque de Madame Du Barry dont elles illustrent parfaitement le goût novateur et raffiné, aux côtés d’un imposant canapé attribué à Delanois et offert par le décorateur Henri Samuel en 1956.
La collection du couple Windsor, où prédominait le style Louis XV, a aussi largement contribué à la restitution de l’appartement de Madame de Pompadour. Ce sont des exemples de la forme primaire du remeublement par équivalence, où ne sont pris en compte que les critères de style et de qualité. Cela permet d’attendre que les objets ayant véritablement appartenu à la comtesse ou à la marquise – rarissimes et toujours hors de prix – puissent être réunis peu à peu. Ce sera alors un progrès majeur, où l’on acceptera sans peine qu’ils aient été livrés pour le château de Bellevue ou l’hôtel d’Évreux, autres résidences de la maîtresse du roi.
Pour les appartements des filles de Louis XV, qui occupèrent Bellevue après la marquise, ce château a fourni d’excellentes équivalences. La dernière en date est une très élégante table de toilette de Levasseur portant la marque BV, offerte en 2024 par la Société des Amis de Versailles et installée dans le cabinet de retraite de Madame Victoire.
L’exemple du cabinet intérieur de Madame Adélaïde
Certains passionnés de Versailles s’amusent à répertorier ces innombrables remplacements, ces objets délégués dans une fonction autre que la leur, mais qu’ils remplissent à merveille. En témoigne le cabinet intérieur de Madame Adélaïde, dont les feux de Pitoin sont issus de celui de Madame Élisabeth, dont les sièges de Jacob proviennent du petit appartement de la Reine, dont l’écran ornait sa chambre à Saint-Cloud et dont les merveilleux dessus-de-porte ont été peints par Restout pour le salon des Jeux à Bellevue… mais dont la commode de Riesener est bien celle qui fut livrée pour cet endroit : acquise lors de la vente Beistegui en 2018 grâce à la Société des Amis de Versailles, c’est l’un des plus beaux exemples récents du « remeublement parfait ».
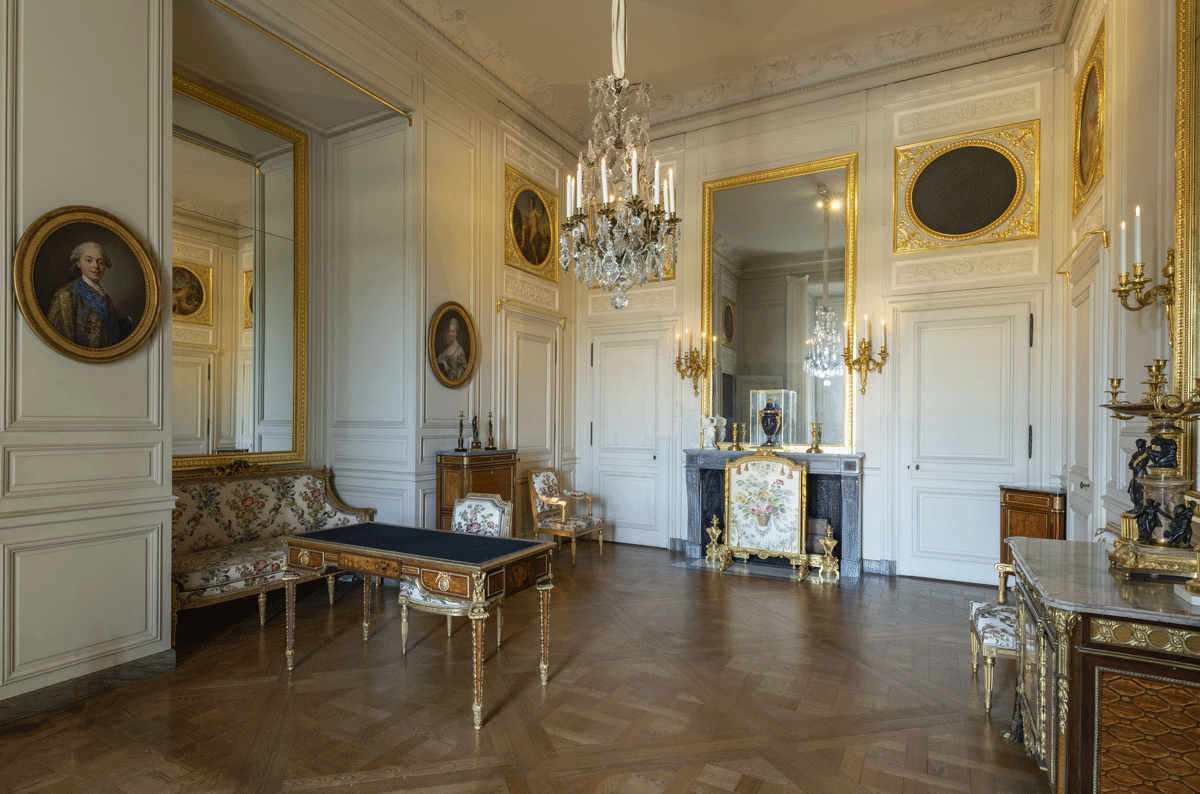
Vue d’ensemble du cabinet intérieur de Madame Adélaïde. © EPV / Christophe Fouin
En revanche, le secrétaire à cylindre du cabinet intérieur de Victoire à Versailles se trouvait dans celui d’Adélaïde à Bellevue ! On pourrait multiplier à l’infini ces exemples de chassé-croisé. Ils ont notamment permis le résultat impressionnant de la recréation des appartements de Mesdames, au rez-de-chaussée du château, mais sont tout aussi omniprésents dans les grands appartements. Cette « cuisine » savante fait partie du charme de Versailles, et cette complexité sur laquelle nous aimons insister régulièrement dans Les Carnets de Versailles, c’est l’Histoire vivante.
Laurent Salomé,
directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
1 Le balustre est le terme utilisé au XVIIe siècle pour désigner la balustrade qui, dans les chambres de parade, fermait l’alcôve.
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).
À REGARDER