La perception du paysage environnant est un sujet majeur pour
le Château, avec la grande perspective de Le Nôtre s’élançant,
jusqu’à l’horizon, au milieu des bois. Depuis le parterre d’Eau,
le parc semble toujours se déployer à l’infini, dominant la nature.
Mais derrière les arbres, aujourd’hui, l’urbanisation menace.
Un nouveau décret, après toute une série de dispositions, vise à éviter
qu’elle ne déborde sur des lieux insignes du patrimoine mondial.
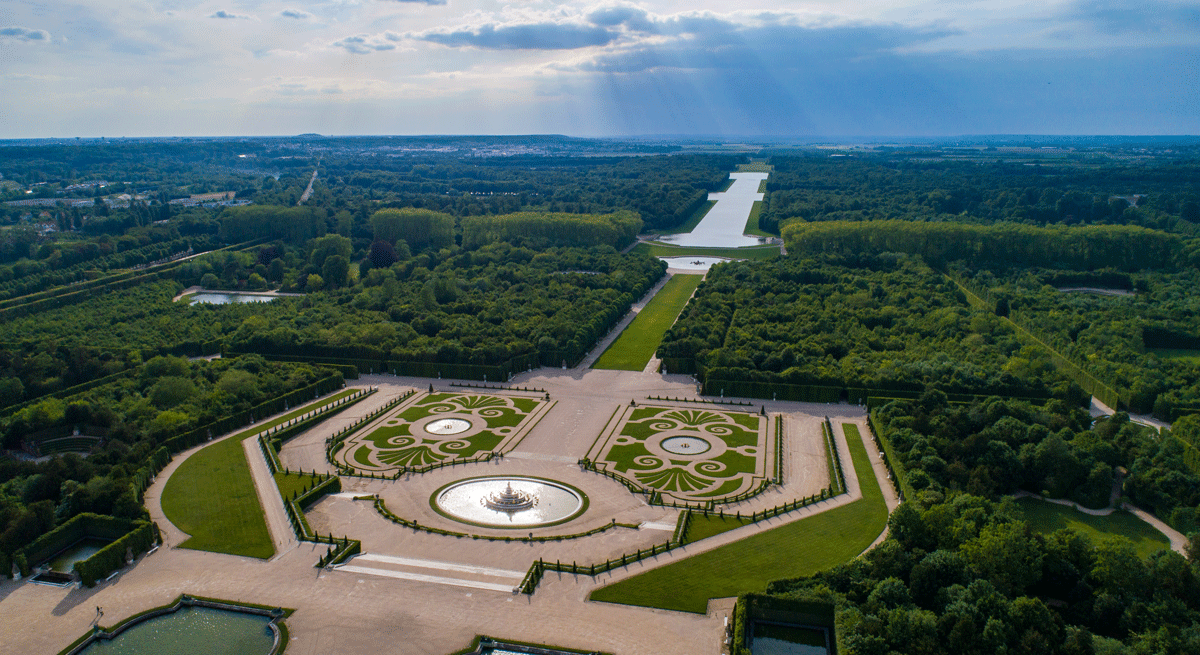
La grande perspective de Le Nôtre partant du château en passant par le parterre de Latone. © EPV / Thomas Garnier
Le domaine national de Versailles a été maintes fois mis sous protection, par passes successives et à travers des dispositifs souvent novateurs. Cette préoccupation permanente, depuis plus de cent cinquante ans, a permis de conserver les bâtiments, mais également le grand paysage alentour qui contribue à la valeur du site.
Une protection de plus en plus étendue et précise
La première protection date de Prosper Mérimée, qui inscrit le château sur sa liste de bâtiments en 1862, puis le classement fondateur au titre des Monuments historiques1 est établi en 1906, et va se préciser au fil des années.
En 1964, le « trou de serrure » – en référence à la forme particulière de ce territoire – est fixé grâce à Malraux à partir de la chambre du Roi. Ce dispositif, unique en son genre, facilite l’intervention de l’architecte des Bâtiments de France. En 1979, le château de Versailles, avec le parc, fait partie des premiers sites français à bénéficier de la protection au titre du patrimoine mondial de l’Unesco.
En 1995, les « biens de retour » sont identifiés en périphérie du domaine afin d’anticiper leur prise en charge : ce dispositif, également inédit, prévoit leur restitution à l’Établissement public du château de Versailles au terme de leur occupation par les autres ministères (Armée, Agriculture, Enseignement supérieur). Enfin, en 2000, c’est la plaine de Versailles qui est définitivement classée au titre des Sites par l’État.

La statue d’Achille à Scyros, par Philibert Vigier, située en bas de l’Allée royale. © EPV / Thomas Garnier
Très récemment encore, la loi LCAP vient à nouveau œuvrer à la préservation d’une zone géographique classée « domaine national » en raison de son lien exceptionnel avec l’histoire de la nation. Ce périmètre a été établi à l’issue de plusieurs années d’études et de nombreuses consultations des différents « propriétaires » impliqués : État, collectivités, entités privées. Ces différentes zones de protection – globalement superposées – s’avèrent complémentaires : elles concernent tels ou tels aspects de l’ancien domaine royal afin d’en sauvegarder le caractère entier et unique.
Petit Parc et Grand Parc
Ainsi, la vigilance des acteurs territoriaux est extrême dès qu’il s’agit de démolir, construire, agrandir ou modifier quoi que ce soit dans un périmètre large autour du château. C’est un enjeu fondamental que d’accompagner l’urbanisation pour bien la maîtriser.
Car il faut savoir que le Grand Parc d’aujourd’hui correspond au Petit Parc d’hier, et que le Grand Parc d’hier s’étendait, à son apogée, sur une surface dix fois plus grande (huit mille hectares). Cet ensemble destiné à la chasse comprenait Marly, plusieurs fermes nourricières, de nombreuses portes, des murs, un système hydraulique ingénieux, etc.

La grande perspective vue depuis le Tapis vert. © EPV / Thomas Garnier
Un patrimoine qui a résisté au temps, mais dont le sens a disparu aux yeux du plus grand nombre. En effet, depuis la construction du château sous Louis XIII, les limites du domaine ont été sans cesse repoussées vers l’ouest depuis sa terrasse : à l’emplacement des jardins, puis à celui du parc que l’on connaît, enfin, à partir de 1680, au-delà de l’Étoile royale. Cet ensemble progressivement déployé est traversé par la Grande Perspective s’achevant par l’allée royale de Villepreux, laissée vierge et partiellement restituée depuis peu. Il s’agissait d’accompagner le regard jusqu’à l’infini, la perspective marquant dans le paysage un grand dessein d’aménagement du territoire, comme les Champs-Élysées depuis les Tuileries.
À l’Étoile royale, au bout du Grand Canal, convergent les allées de l’ancien Petit Parc et démarrent celles qui traversaient l’ancien Grand Parc. Les allées de Maintenon et de Saint-Cyr avaient une utilité, desservant, la première, le parc de Marly, la seconde, la Maison royale de Saint-Louis2. Les deux autres, celles de Fontenay et de la Tuilerie, étaient seulement destinées à la composition. Elles partaient à la conquête de la plaine, mais s’y interrompaient, comme attendant d’autres extensions du domaine qui avait déjà englobé des villages entiers.
Ces villages d’autrefois ont été soumis à une pression foncière de plus en plus forte. Si l’on n’y prend garde, le tracé ténu de ces allées historiques s’estompera définitivement. Or, il en reste des vestiges, parvenus jusqu’à nous grâce à une attention qui fait de nous aujourd’hui des héritiers.
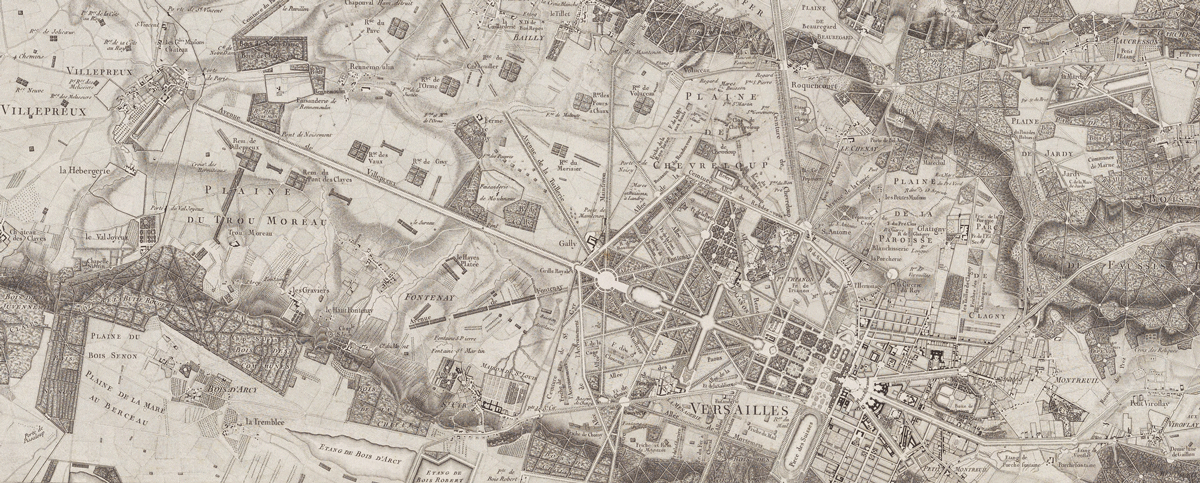
Carte topographique des environs de Versailles dite Carte des chasses [détail], 1792, Paris, Bibliothèque nationale de France. © Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF) / Département cartes et plans
Les perspectives côté ville
À l’autre extrémité du domaine, trois axes principaux – visibles depuis la chambre du Roi – partent « en patte d’oie » du château et ouvrent des perspectives qui dépassent largement les limites de la ville, creusant leur sillon dans son plan en damier. Ces axes historiques ont déterminé une forme urbaine caractéristique qui a inspiré, outre Paris, d’autres villes à travers le monde, notamment Washington.
Leur histoire se poursuit au-delà du quartier de Porchefontaine, dans le prolongement de l’avenue de Paris qui franchissait autrefois le coteau de Viroflay jusqu’à Vélizy. Il ne s’agit plus aujourd’hui que d’un chemin forestier assez dégradé, désigné sur les cartes « route des Célestins », que l’Office national des forêts a envisagé de revaloriser pour évoquer l’extrémité à l’est de la grande perspective de Le Nôtre qui s’appelait alors l’allée du Point-de-Vue.
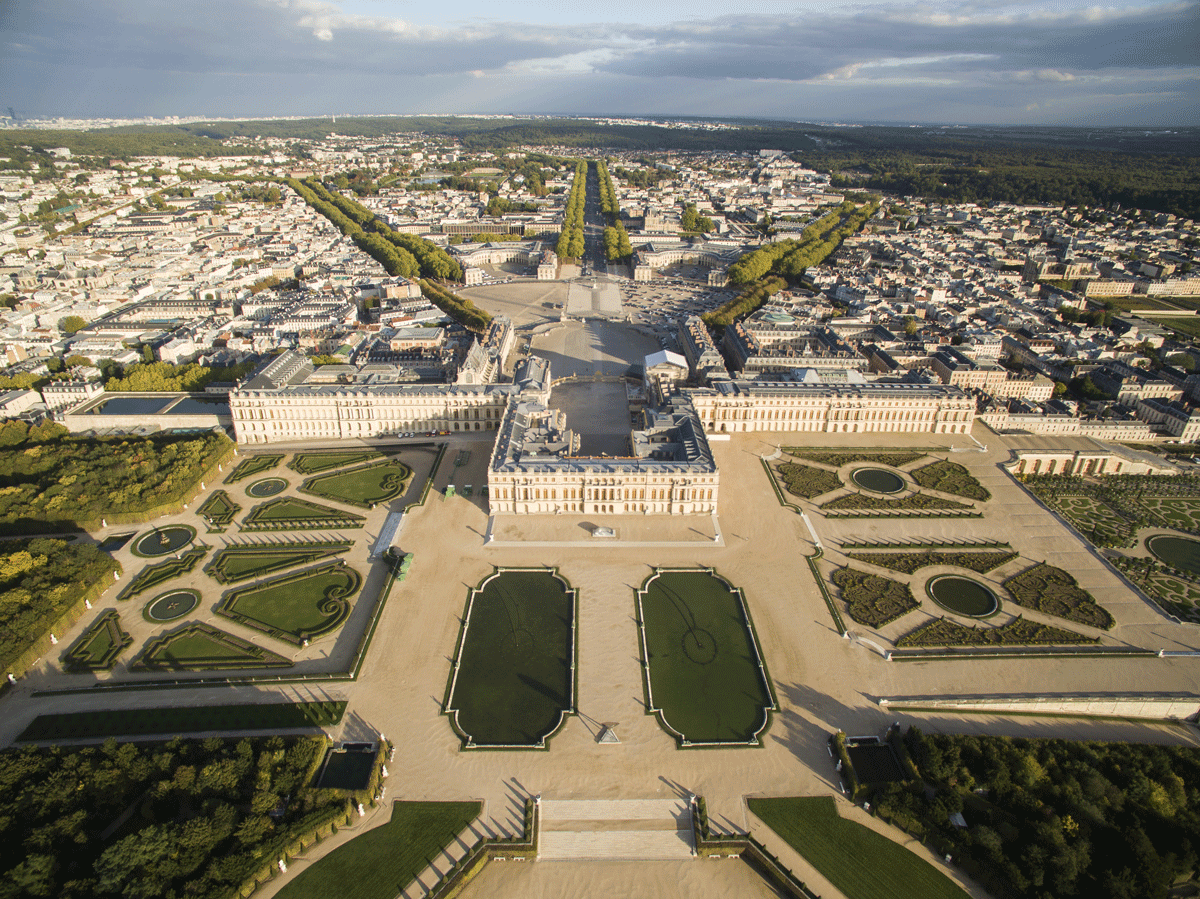
Le château de Versailles et les trois avenues qui en partent à travers la ville, prolongeant la perspective de Le Nôtre côté est. © EPV / Thomas Garnier
Récents aménagements
Au fond du parc, à l’ouest, l’accueil des épreuves équestres des Jeux olympiques et paralympiques a révélé l’Étoile royale comme zone patrimoniale digne d’intérêt et agréable à parcourir. Une zone qui est redevenue, depuis la nouvelle station de tramway « Allée royale », un accès au domaine. Le public peut en apprécier le glacis de gazon revalorisé. Accéder par cet endroit redonne aux visiteurs un sentiment de cohérence territoriale, avec le château à l’horizon, dans l’aboutissement de la perspective illuminée par les ors de la Chapelle royale.
Autre délaissé périphérique du domaine, où se sont accumulés au fil des années des usages tiers qui empêchent la lecture historique du site : les Mortemets, que les replantations de chênes et de tilleuls requalifient progressivement. Quant aux développements récents aux alentours – le nouveau quartier de Gally, le tramway T13, l’allée de Villepreux, le parking en substitution de l’ancien moulin, le dépôt de bus « propres », l’échangeur de la RN12 –, ils s’inscrivent dans cette attention partagée par les partenaires territoriaux du ministère de la Culture, qui s’ingénient à trouver des solutions aux besoins contemporains tout en respectant cet héritage national.
Sophie Lemonnier,
directrice du patrimoine et des jardins de l’Établissement public de Versailles
1 Le classement fondateur au titre des Monuments historiques, en 1906, comprend le palais de Versailles et ses dépendances, le Petit Parc et le Grand Parc ainsi que « le palais et le parc des deux Trianons ».
2 Pensionnat pour jeunes filles pauvres de la noblesse créé à Saint-Cyr par Madame de Maintenon.
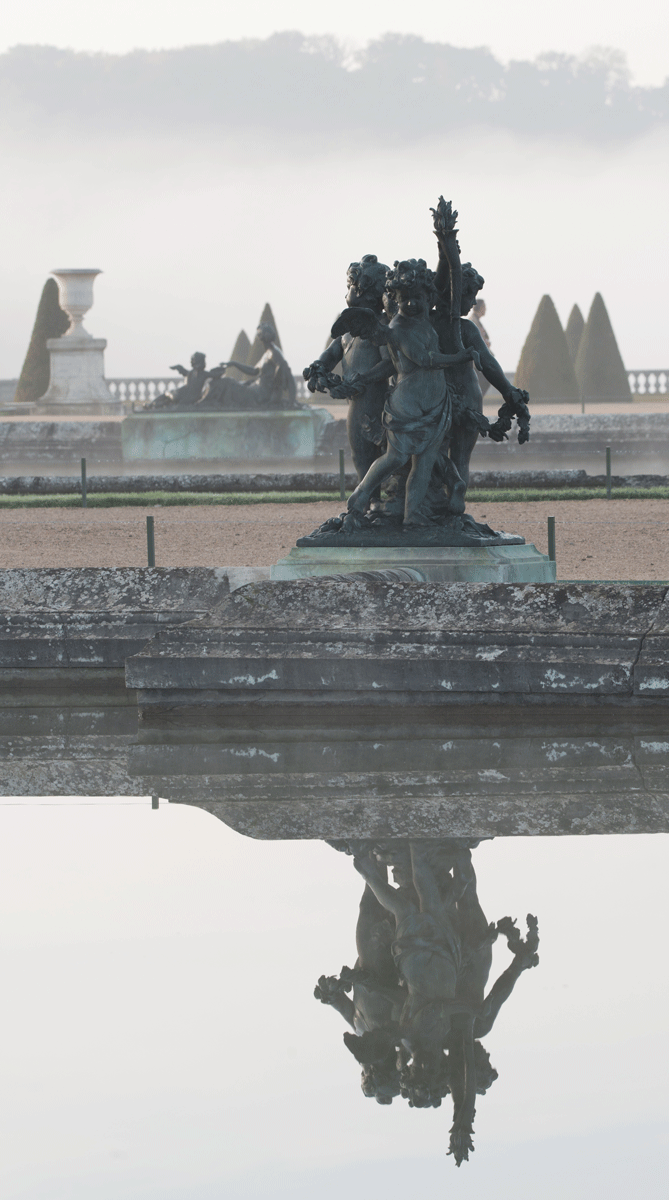
La statue Un Amour tenant un flambeau et deux enfants, par Pierre Granier, située sur le parterre d’Eau.
© EPV / Thomas Garnier
La loi LCAP : une loi adaptée à l’histoire du domaine de Versailles
Le 24 mai 2024, le domaine du château de Versailles était inscrit sur la liste des domaines nationaux par le décret 2024-472 en application de la loi LCAP (relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine).
Cette loi, adoptée en 2016, permet de délimiter un territoire à protéger en fonction de son intérêt historique, mais aussi de sa cohérence d’origine, indépendamment de son occupation actuelle. Elle prend en compte les abords des monuments historiques selon des périmètres délimités en collaboration avec les communes et les habitants.
« En vertu de cette nouvelle qualité, ces ensembles immobiliers seront, dans les périmètres fixés et pour les emprises appartenant à l’État, inaliénables, imprescriptibles et inconstructibles, à l’exception des bâtiments et structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public, ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur. »
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°26 (avril – septembre 2025).