Ces laiteries qui, dès la Renaissance, furent associées à l’imaginaire pastoral, ont presque toutes disparu. Celles de Rambouillet et de Trianon, toutes deux pour Marie-Antoinette, forment ainsi de rares témoignages
de ces édifices à la gloire du lait, qui se sont multipliés
avec le développement du jardin paysager.

Domaine national de Rambouillet, rotonde d’entrée de la laiterie de la Reine (dite « laiterie de propreté »).
Au second plan, une grotte, sanctuaire des nymphes, abrite une ronde-bosse signée de Pierre Julien représentant Amalthée et la chèvre de Jupiter. © Domaine national de Rambouillet, Laiterie de la Reine / Photographe : Céline Clanet / Centre des monuments nationaux
Niché dans un écrin de verdure au cœur du domaine national de Rambouillet, le mystérieux bâtiment porte l’inscription « LAITERIE DE LA REINE » sur son portique d’entrée. Le mérite en revient pourtant à Louis XVI. Ayant acquis le giboyeux duché de Rambouillet en 1783, pour donner libre cours à sa passion pour la chasse, le roi fut soucieux d’attirer Marie-Antoinette en ces lieux qu’elle n’appréciait guère et qu’elle aurait qualifiés de « crapaudière ». Louis XVI fit ainsi entreprendre, à partir de 1785, la construction d’une laiterie destinée aux réunions bucoliques de la reine, qui venait de s’en faire aménager une dans le domaine de Trianon.
Des fabriques pour la production et la dégustation des laitages
Ce type d’édifice était alors particulièrement en vogue : la découverte progressive des vertus diététiques et médicinales du lait avait conduit à la construction, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreuses laiteries dans les parcs des demeures aristocratiques. Destinées à la production de beurre, crèmes et fromages, elles étaient édifiées dans un endroit ombragé, présentaient peu d’ouvertures et un revêtement intérieur en pierre ou en marbre, ainsi que des installations hydrauliques, afin d’assurer une fraîcheur indispensable à la bonne conservation des laitages.
« Les laiteries relevaient néanmoins plus du divertissement pour une noblesse très attirée, à la fin du XVIIIe siècle, par la vie rustique. »
Les laiteries relevaient néanmoins plus du divertissement pour une noblesse très attirée, à la fin du XVIIIe siècle, par la vie rustique. Furent alors dissociées les laiteries dites « de préparation », où les laitages étaient élaborés, et celles dites « d’agrément », dans lesquelles ils étaient savourés. Ces dernières étaient pourvues de tables et tablettes d’appui en marbre, auxquelles pouvaient s’ajouter des tables et des sièges en bois, et comportaient des pièces de faïence ou de porcelaine nécessaires à la dégustation des produits laitiers.
Un décor néoclassique, sous la direction de Hubert Robert, pour la laiterie de Rambouillet
Ornées d’un décor peint ou sculpté, les laiteries revêtaient une apparence souvent rustique, parfois néoclassique, à l’instar de celle de Rambouillet dont la conception fut intégralement confiée à Hubert Robert. Le peintre, qui s’était formé à Rome de 1754 à 1765, assura l’homogénéité stylistique et décorative de cet édifice dont l’architecture, le décor sculpté et le mobilier sont imprégnés de l’esprit antique si cher à la fin du XVIIIe siècle.
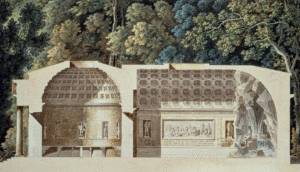
Coupe transversale de la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet (projet), par Charles Percier, vers 1805, Berlin, Kunstbibliothek (SMPK). © BPK, Berlin, Dist. GrandPalaisRmn / image BPK
Bâtie en grès blanc par l’architecte Jacques-Jean Thévenin, la laiterie de la Reine s’élève dans l’axe d’une ménagerie où se trouve, en sous-sol, la laiterie de préparation. Son entrée est soulignée par deux colonnes toscanes baguées surmontées d’un fronton cintré et ouvre sur deux salles. La rotonde est inspirée de celle des thermes de Dioclétien, à Rome : creusée de six niches et pourvue de tables d’appui en marbre, elle est couverte d’une coupole à caissons percée d’un oculus sommital. Voûtée en berceau, la salle rectangulaire comprend une grotte artificielle dans laquelle de l’eau s’écoulait en cascade.
Service de porcelaine aux « bols seins »
Cette laiterie, pour laquelle Georges Jacob exécuta le somptueux ensemble de meubles en acajou, était aussi dotée d’un extraordinaire service en porcelaine. Livré par la Manufacture royale de Sèvres en 1787-1788, celui-ci comprenait soixante-cinq pièces parmi lesquelles quatre « bols seins » dont la forme – qui ne fut pas moulée sur la poitrine de Marie-Antoinette comme le veut la légende – est inspirée du mastos1 antique. L’édifice sert toujours d’écrin aux marbres sculptés par Pierre Julien en 1786-1787 illustrant les travaux de la métairie et les bienfaits du lait, incarnés par le groupe, disposé dans la grotte, d’Amalthée et la chèvre de Jupiter.
Antoine Maës,
docteur en histoire de l’art
1 Dans la Grèce antique, un vase à boire en céramique pourvu de deux anses dont la forme imite le sein d’une femme.
Cet article est extrait des Carnets de Versailles n°25 (octobre 2024 – mars 2025).

Intérieur de la laiterie de la Reine au Hameau. © EPV / Didier Saulnier
Des laiteries royales et princières
Déjà, au XVIe siècle, Catherine de Médicis disposait d’une laiterie à Fontainebleau « pour là quelquefois y aller se divertir ».
À Versailles, trois premières laiteries, aujourd’hui disparues, sont connues. Au temps de Louis XIV, deux d’entre elles furent successivement aménagées, par Louis Le Vau en 1662-64, puis Jules Hardouin-Mansart en 1698 pour la duchesse de Bourgogne, dans la ménagerie qui était située à l’extrémité d’un bras du Grand Canal. Puis Louis XV en fit bâtir une par Ange-Jacques Gabriel au sein du jardin français de Trianon pour madame de Pompadour, à proximité du Pavillon français et du Pavillon frais dans lesquels les laitages étaient consommés.
L’apparition du jardin paysager dit « à l’anglaise » favorisa le développement de ces fabriques qui s’accordaient merveilleusement bien au goût champêtre. L’artiste et auteur d’un Essai sur les jardins, Claude-Henri Watelet, donna l’exemple à son Moulin-Joli en 1754. Il inspira, notamment, le prince de Condé au hameau de Chantilly (1774-75), Mesdames à Bellevue (1781), Marie-Antoinette à Trianon (dès 1783), la comtesse de Provence au hameau de Montreuil (vers 1784), le duc d’Orléans au Raincy (vers 1786), Louis XVI à Rambouillet (1786) et Jean-Joseph de Laborde à Méréville (1790-92).
À VOIR
La laiterie du domaine de Rambouillet, avec l’espace de médiation ouvert à côté, depuis l’automne 2023, dans le pavillon du Roi, évoquant l’atmosphère qui régnait au sein de la laiterie de la Reine à la veille de la Révolution. Renseignements pratiques.
La laiterie du hameau de la Reine, à Trianon, dans le cadre de la visite guidée
« Le Hameau, de Marie-Antoinette à Marie-Louise » (sur réservation)
À LIRE
Antoine Maës, La Laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet. Un temple pastoral pour le plaisir de la reine, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2016.
Renaud Serrette et Gabriel Wick (dir.), Vivre à l’antique de Marie-Antoinette à Napoléon Ier, Paris / Saint-Rémy-en-L’Eau, Centre des Monuments nationaux / Éditions Monelle Hayot, 2021.